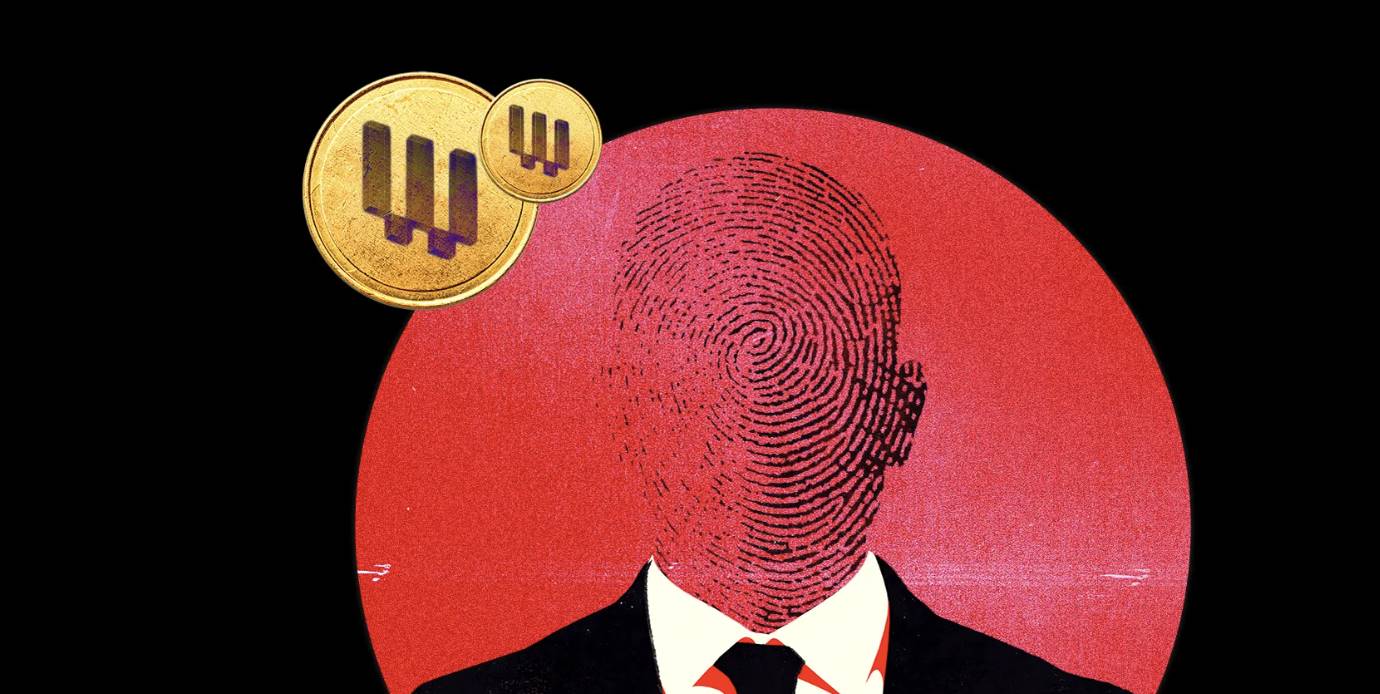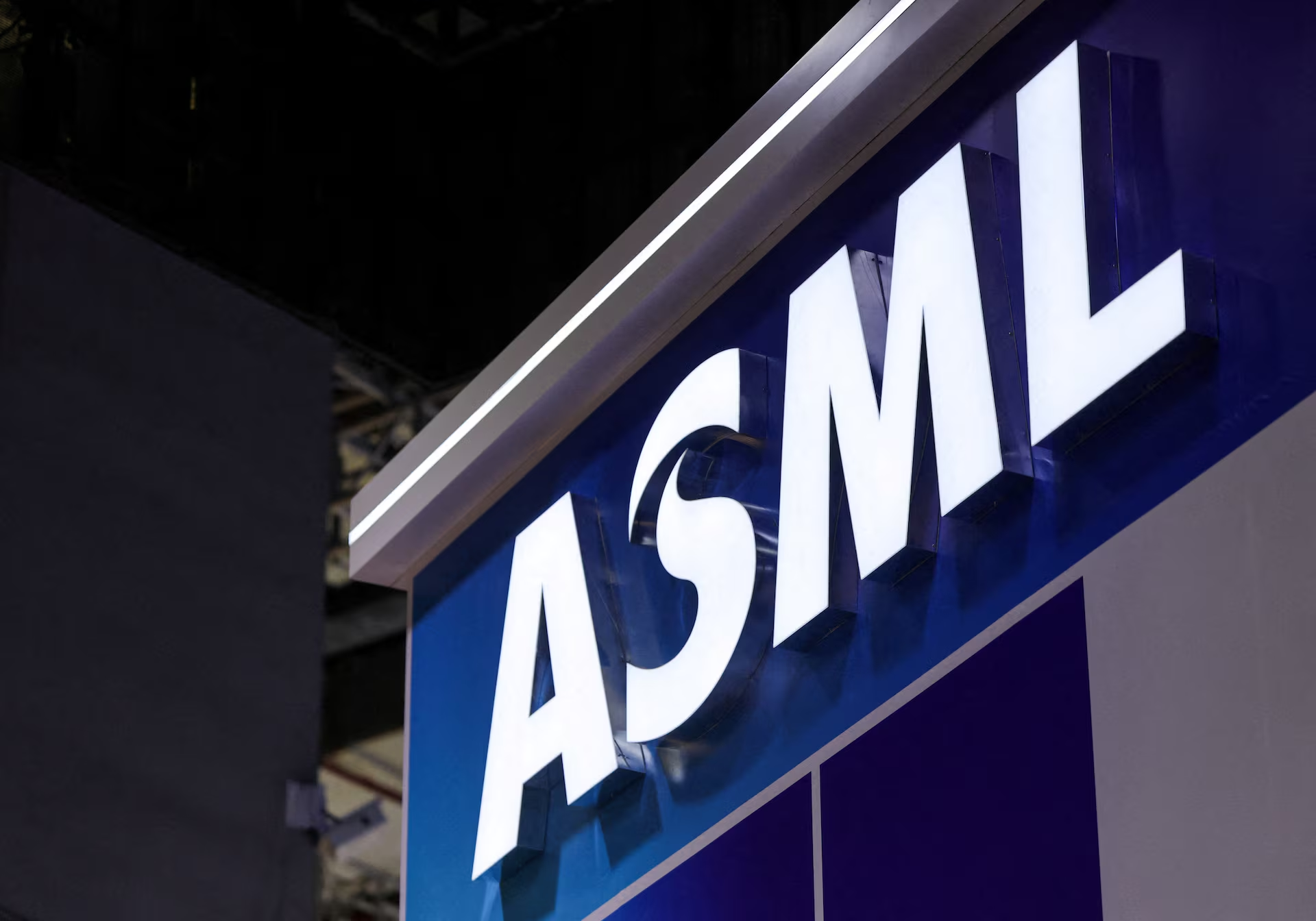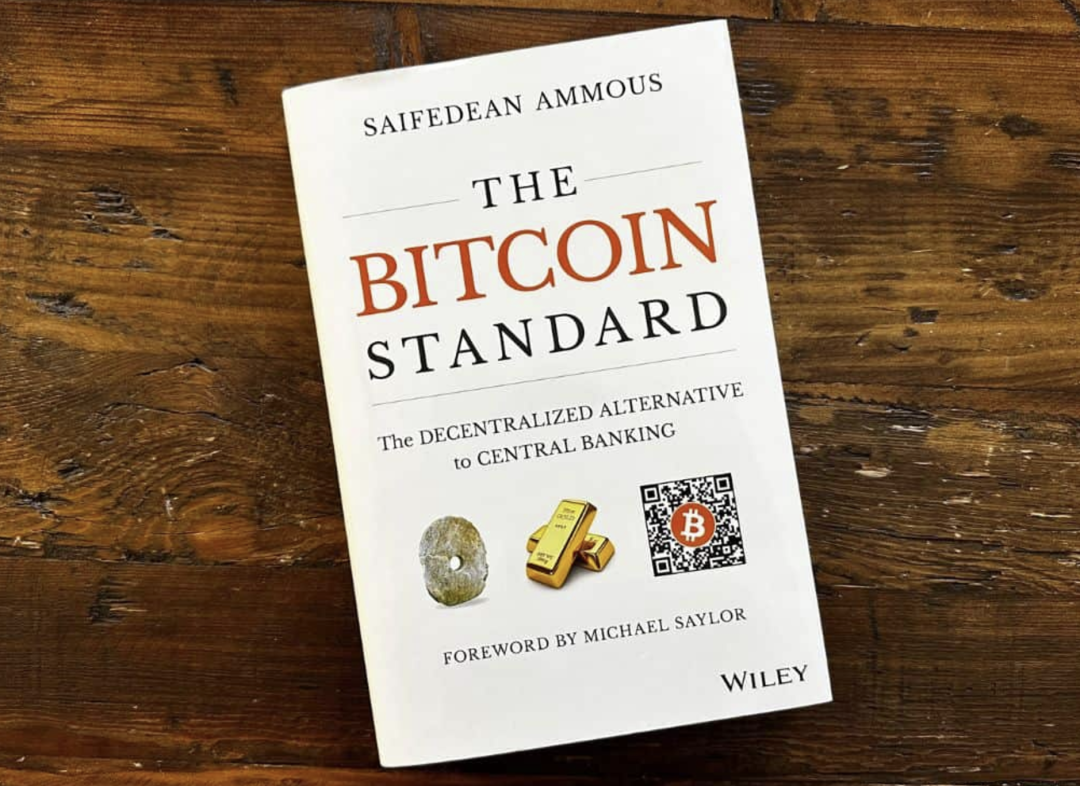Il a révélé les dessous des « parcs de fraude cryptographique » en Asie du Sud-Est, puis s’est échappé.
TechFlow SélectionTechFlow Sélection

Il a révélé les dessous des « parcs de fraude cryptographique » en Asie du Sud-Est, puis s’est échappé.
L’histoire d’un indicateur coincé dans un centre d’escroquerie, déterminé à dévoiler les crimes de ses geôliers, puis à s’enfuir coûte que coûte.
Texte : Andy Greenberg, Wired
Traduction : Luffy, Foresight News
Un appel à l’aide venu du Triangle d’or
C’était une belle soirée de juin à New York lorsque j’ai reçu le premier courriel de cette source anonyme, qui m’a demandé de l’appeler « Red Bull ». À ce moment-là, il se trouvait à 8 000 miles de là, dans un véritable enfer sur terre.
Après une averse estivale, un arc-en-ciel s’était formé au-dessus des rues de Brooklyn, tandis que mes deux enfants s’amusaient dans la petite piscine située sur le toit de notre immeuble. Le soleil se couchait, et moi, comme bon nombre de parents du XXIe siècle, je naviguais distraitement entre les applications de mon téléphone.
Le courriel n’avait pas de sujet et provenait d’un service de messagerie chiffrée, Proton Mail. J’ai cliqué dessus.
« Bonjour, j’occupe actuellement un poste au sein d’un important réseau de fraude cryptomonnaie basé dans le Triangle d’or », commençait le message. « Je suis ingénieur informatique, contraint de signer un contrat pour y travailler. »
« J’ai rassemblé des preuves concrètes détaillant chaque étape de ce processus frauduleux », poursuivait-il. « Je me trouve encore à l’intérieur du complexe, donc je ne peux pas prendre le risque de révéler mon identité réelle. Mais je souhaite contribuer à faire tomber ce repaire. »
Je savais vaguement que le Triangle d’or désignait une zone sauvage et hors-la-loi d’Asie du Sud-Est. En tant que journaliste spécialisé depuis quinze ans dans les crimes liés aux cryptomonnaies, je connaissais bien ce type de fraude — aujourd’hui communément appelée « arnaque au porc » : les escrocs séduisent leurs victimes sous couvert de relations amoureuses ou de placements à haut rendement afin de leur soutirer toute leur épargne — devenue la forme de cybercriminalité la plus lucrative au monde, avec des pertes annuelles s’élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Aujourd’hui, cette industrie tentaculaire fonctionne grâce à des dizaines de milliers de travailleurs forcés détenus dans des complexes d’escroquerie établis au Myanmar, au Cambodge et au Laos. Ces victimes sont enlevées dans les régions les plus pauvres d’Asie et d’Afrique, puis contraintes de servir des organisations criminelles. Ce système engendre un entonnoir financier mondial auto-entretenu et en constante expansion, plongeant dans le désespoir les deux extrémités du dispositif : d’un côté, les victimes ruinées ; de l’autre, les travailleurs esclavagisés des complexes.
J’avais lu d’innombrables récits tragiques sur ces complexes : travailleurs battus, soumis à des décharges électriques, affamés, voire assassinés par leurs geôliers. La plupart de ces histoires proviennent de rares survivants ayant réussi à s’échapper ou secourus par les forces de l’ordre. Mais jamais auparavant je n’avais rencontré un témoin interne encore détenu au cœur même d’un tel complexe — un véritable indicateur vivant.
Je n’étais toujours pas certain de l’existence réelle de cet informateur autoproclamé. Pourtant, j’ai répondu à son courriel, lui suggérant de passer à l’application de messagerie chiffrée Signal, avec la fonction « effacement automatique après lecture » activée afin de mieux dissimuler ses traces.
L’indicatif répondit immédiatement, me demandant de l’attendre deux heures avant de le contacter à nouveau.
Red Bull, prisonnier du complexe
Ce soir-là, après que les enfants eurent sombré dans un profond sommeil, mon téléphone se mit à vibrer sans cesse, signalant l’arrivée de nouveaux messages Signal. Tout d’abord, il m’envoya des documents soigneusement organisés : un diagramme, suivi d’un guide écrit détaillant intégralement le processus frauduleux mis en œuvre dans ce complexe situé dans le nord du Laos. (J’ai appris par la suite que le terme « Triangle d’or », autrefois utilisé par les Américains pour désigner la région géante de production d’opium et d’héroïne, désigne désormais principalement une « zone économique spéciale » de taille urbaine située dans le nord du Laos, à la frontière avec le Myanmar et la Thaïlande, et largement contrôlée par des intérêts commerciaux chinois.) Ces deux documents décrivaient minutieusement chaque étape opérationnelle du complexe : création de faux comptes Facebook et Instagram ; recrutement de mannequins et utilisation d’outils d’IA pour générer des avatars convaincants de partenaires amoureux ; incitation des victimes à « investir » sur des plateformes d’échange fictives recommandées. Ils mentionnaient même la présence, dans les bureaux, d’un petit gong frappé à chaque réussite frauduleuse.
Je n’avais pas encore eu le temps de parcourir ces documents détaillés, alors que j’envisageais de passer une agréable soirée de samedi avec ma femme, quand, juste après minuit, mon téléphone sonna.
J’ai décroché l’appel vocal Signal. Une voix polie, aux accents indiens, retentit : « Bonjour. »
« Comment dois-je vous appeler ? » demandai-je.
« Frère, appelez-moi comme vous voulez, cela n’a aucune importance », répondit-il avec un sourire timide audible dans sa voix.
J’insistai pour obtenir un nom, même inventé sur-le-champ.
« Vous pouvez m’appeler Red Bull », dit-il. Des mois plus tard, il m’expliqua qu’il avait tenu cette conversation en regardant une canette vide de boisson énergisante Red Bull.
Red Bull m’expliqua qu’il avait déjà contacté des autorités américaines et indiennes, ainsi qu’Interpol, et laissé des messages sur les lignes d’alerte de plusieurs médias, mais que j’étais le seul à avoir répondu. Il me demanda de parler davantage de moi-même, mais dès que j’eus prononcé deux phrases sur mon travail de journaliste spécialisé dans les crimes liés aux cryptomonnaies, il m’interrompit.
« Alors vous êtes la personne à qui je peux tout confier », dit-il avec empressement. « Vous allez exposer tout cela, n’est-ce pas ? »
Décontenancé, je lui répondis qu’il devait d’abord me dire qui il était.
Pendant les minutes suivantes, Red Bull répondit à mes questions avec prudence. Il refusa de révéler son vrai nom, se contentant de dire qu’il venait d’Inde, et que la plupart des travailleurs forcés du complexe étaient originaires d’Inde, du Pakistan ou d’Éthiopie.
Il précisa avoir dans la vingtaine et être titulaire d’un diplôme en génie informatique. Comme la plupart de ses collègues, Red Bull avait été piégé par une offre d’emploi trompeuse promettant un poste de chef IT dans un bureau au Laos. À son arrivée, on lui avait confisqué son passeport. Il fut contraint de partager une chambre avec cinq autres hommes, travaillant selon un horaire de nuit de quinze heures consécutives — un horaire calibré pour coïncider avec les heures de journée de ses cibles : des Américains d’origine indienne. (J’ai appris par la suite que cette pratique consistant à appairer les escrocs avec des victimes de même origine ethnique est très répandue, afin de créer une fausse impression de confiance et d’éviter les barrières linguistiques.)
La situation de Red Bull n’était pas aussi brutale que les cas extrêmes d’esclavage moderne que j’avais pu observer auparavant, mais ressemblait plutôt à une caricature grotesque d’un département commercial d’entreprise. En théorie, le complexe incitait ses employés à la performance via des commissions, cultivant l’illusion qu’un travail acharné pouvait mener à la richesse foudroyante. En réalité, les employés restaient perpétuellement endettés, réduits à l’esclavage indirect. Red Bull m’expliqua que son salaire mensuel de base s’élevait à 3 500 yuans (environ 500 dollars), mais qu’il était presque entièrement dévoré par des amendes arbitraires — notamment pour ne pas avoir atteint les objectifs minimums de « premiers contacts » avec les victimes. À la fin du mois, il ne touchait pratiquement aucun revenu réel, se nourrissant uniquement des repas fournis à la cantine, composés essentiellement de riz et de légumes, dont il affirmait qu’ils avaient « un goût chimique étrange ».
Il était lié par un contrat d’un an, espérant qu’à son terme, il serait autorisé à quitter les lieux. Il m’indiqua qu’il n’avait jusqu’ici réussi à escroquer personne, se bornant à remplir péniblement le quota minimal de « premiers contacts » fictifs. Cela signifiait qu’il resterait prisonnier de ce lieu indéfiniment, à moins de s’enfuir, d’attendre la fin de son contrat, ou de produire des milliers de dollars qu’il ne possédait pas pour racheter sa liberté.
Red Bull raconta avoir entendu parler de collègues battus, soumis à des décharges électriques, et d’une femme qu’il pensait avoir été vendue comme esclave sexuelle. D’autres collègues avaient tout simplement disparu mystérieusement. « S’ils découvrent que je suis en contact avec vous, qu’ils apprennent que je leur fais obstacle, ils me tueront sans hésiter », dit-il. « Mais je me suis juré, quoi qu’il arrive, de mettre fin à cette escroquerie, même si cela doit me coûter la vie. »
Recueillir des preuves au cœur du repaire
Ensuite, Red Bull exposa l’urgence de cet appel : il avait appris que le complexe préparait une nouvelle escroquerie visant un homme américain d’origine indienne, déjà victime d’une première arnaque, mais encore manipulé par l’un de ses collègues. Le fournisseur de services de portefeuille cryptomonnaie de la victime semblait avoir détecté la fraude et gelé son compte. Le complexe envisageait donc d’envoyer un intermédiaire récupérer une somme en espèces à six chiffres que la victime s’apprêtait à verser.
Le retrait devait avoir lieu dans trois ou quatre jours, et la victime habitait à quelques heures seulement de chez moi. Red Bull expliqua que, si j’agissais rapidement, je pouvais alerter les forces de l’ordre afin de monter un guet-apens permettant d’arrêter l’intermédiaire. En complément de cette information, il souhaitait également que je mette en relation avec un agent du FBI, qui deviendrait son interlocuteur officiel par la suite, tandis qu’il continuerait à collaborer avec moi en tant qu’informateur. Notre conversation ne dura que dix minutes.
Red Bull, impatient, déclara qu’il m’enverrait les détails par Signal, puis raccrocha. Quelques secondes plus tard, il m’envoyait des captures d’écran des conversations internes du complexe, des échanges entre son collègue et la victime, ainsi que d’autres éléments précis concernant l’opération de guet-apens qu’il espérait me voir organiser.
Mon esprit était en pleine confusion. Après une courte pause, je rappelai Red Bull sur Signal, en activant la vidéo. Je voulais voir qui se trouvait derrière cette voix.
Première image transmise par Red Bull lors de son appel vidéo initial avec Wired, prise depuis sa chambre d’hôtel
Red Bull accepta l’appel vidéo. Il était mince, aux traits fins, avec des cheveux bouclés et une barbe soignée. Il m’adressa un léger sourire, apparemment indifférent à l’exposition de son visage. Je lui demandai de me montrer son environnement. Il pivota la caméra pour révéler une chambre d’hôtel vide. Il m’expliqua qu’il avait pris le risque de louer cette chambre, voisine du bureau, afin de pouvoir converser en toute sécurité avec moi. Par la fenêtre, on apercevait des bâtiments en béton disgracieux, un parking, un chantier de construction et quelques palmiers.
À ma demande, il sortit à l’extérieur pour me montrer l’enseigne en chinois à l’entrée du bâtiment. Bien que peu familier avec le Triangle d’or, je compris immédiatement que ce que je voyais correspondait exactement à ce que j’avais imaginé.
Enfin, Red Bull me montra sa carte professionnelle, sur laquelle figurait le nom chinois que le complexe lui avait attribué : Ma Chao. Il m’expliqua que personne, au bureau, ne connaissait les véritables noms des employés.
Je commençai à croire que Red Bull disait la vérité : il était bel et bien un véritable lanceur d’alerte travaillant à l’intérieur d’un complexe d’escroquerie au Laos. Je lui répondis que je prendrais en compte toutes ses demandes, mais que je souhaitais coopérer avec lui de manière patiente et prudente, afin de minimiser au maximum les risques qu’il encourait.
« Je vous fais confiance, je me fie entièrement à vos décisions », répondit-il à 1 h 33 du matin. « Bonne nuit. »
À 4 h du matin, je restais allongé, incapable de dormir, réfléchissant intensément à la manière d’aborder ce nouvel informateur passionné, prêt à confier sa vie entre mes mains.
Après quelques heures de sommeil, j’envoyai un SMS à Erin West, procureure californienne — ou, comme je l’appris lors de notre conversation téléphonique plus tard dans la journée, ancienne procureure. À la fin de l’année 2024, profondément déçue par l’inaction du gouvernement américain face à la prolifération des « arnaques au porc », elle avait pris sa retraite anticipée de son poste de procureure adjointe du district, pour se consacrer à plein temps à son organisation antifraude, Operation Shamrock.
Je consultai West sur la personne à contacter au sein des forces de l’ordre afin de coordonner le guet-apens proposé par Red Bull. À ma grande surprise, West manifesta un enthousiasme bien supérieur à ce que j’espérais quant à l’article que Red Bull souhaitait que je rédige. « C’est un événement majeur », dit-elle. « Enfin, un témoin interne accepte de révéler ces informations et de dévoiler totalement le fonctionnement interne de cette escroquerie. »
Elle rejeta toutefois rapidement l’idée du guet-apens. Selon elle, il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour le mettre en place, et surtout, elle estimait qu’arrêter un simple intermédiaire ne constituerait pas, aux yeux de Red Bull, une victoire significative. Elle précisa que ces intermédiaires étaient souvent des travailleurs indépendants, occupant un rang inférieur à celui de Red Bull au sein de la hiérarchie criminelle, et ignorant totalement toute information utile.
Plus grave encore, la mise en place d’un guet-apens, ou même ma propre tentative de contacter directement la victime via Red Bull pour l’avertir, risquait de révéler au complexe l’existence d’une taupe interne. Cette piste pourrait inévitablement remonter jusqu’à Red Bull, le mettant en danger mortel. Exposer sa vie pour empêcher une escroquerie à six chiffres ou arrêter un intermédiaire était tout simplement inacceptable.
Moins de 24 heures après avoir pris contact avec Red Bull, j’avais déjà pris ma décision : pour le protéger, je devais rester spectateur, même si cette escroquerie à six chiffres allait bientôt se produire.
West m’indiqua également que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, confier Red Bull au FBI ne constituait pas non plus la meilleure solution. Selon elle, s’il devenait un indicateur officiel des forces de l’ordre, le FBI ou Interpol exigeraient presque certainement qu’il cesse tout contact avec moi, ou avec tout autre journaliste. Et toutes les informations qu’il fournirait aux autorités fédérales aboutiraient probablement à des résultats bien inférieurs à ses attentes : au mieux, des inculpations par contumace contre des chefs de niveau intermédiaire. « S’il pense que le FBI ou Interpol vont entrer au Laos pour démanteler ce complexe, c’est absolument impossible. Personne ne viendra le sauver », ajouta-t-elle.
Elle considérait que, plutôt que de concentrer les efforts sur la poursuite d’un seul complexe, il serait bien plus pertinent d’utiliser toutes les informations fournies par Red Bull pour raconter une histoire plus vaste : décrire l’état réel des complexes d’escroquerie, détailler leur mode opératoire et leur ampleur. Ces aspects avaient certes déjà été évoqués par des survivants, mais, selon West, jamais un indicateur interne n’avait jamais fourni, en temps réel, des documents et des preuves aussi exhaustives.
West m’expliqua que, depuis la suppression de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) par l’administration Trump — qui finançait auparavant des organisations humanitaires dans la région —, il était devenu de plus en plus difficile d’évaluer l’ampleur du trafic humain derrière ces complexes. « Avec l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump, nous avons perdu tous nos contacts locaux », déclara West.
Tout cela permettait aux groupes criminels de poursuivre impunément leur système d’esclavage, volant ainsi la richesse de notre génération, comme le décrivait West, un système qui s’était progressivement emparé d’une vaste portion du monde. « Le cœur de cette histoire, c’est la façon dont nous avons permis à ces criminels de s’implanter en Asie du Sud-Est comme un cancer gangréneux », dit West. « Et comment tout cela détruit la confiance entre les êtres humains. »
Je fis part à Red Bull de ma décision de ne pas organiser de guet-apens, pour sa propre sécurité. Je lui expliquai également que, s’il souhaitait continuer à collaborer avec moi en tant qu’informateur, il devrait temporairement suspendre tout contact avec les autorités. Il accepta cette décision avec une rapidité surprenante. « Très bien, comme vous le souhaitez », dit-il.
Très vite, Red Bull et moi établîmes un rythme de communication fixe : des appels quotidiens le matin, heure de New York — soit vers 22 h au Laos —, juste après son réveil, avant d’aller à la cantine, durant les trente minutes où il pouvait circuler librement à l’extérieur de sa chambre. Ce repas terminé, il devait entamer environ quinze heures de travail, ponctuées seulement de deux pauses repas.
Lors de nos premiers échanges, il passa la majeure partie du temps à proposer des méthodes de collecte de preuves de plus en plus risquées : porter une caméra cachée ou un micro ; installer un logiciel de bureau à distance pour que je puisse voir en temps réel son écran ; installer un logiciel espion sur l’ordinateur de son chef — un employé d’origine indienne, portant des lunettes de pilote et une courte barbe, surnommé « Amani » ; ou encore pirater l’ordinateur portable de son supérieur, surnommé « 50k », un homme chinois trapu, vêtu de pantalons moulants et portant un tatouage sur la poitrine que Red Bull n’avait jamais pu identifier clairement. Il pensait que ce logiciel espion pourrait nous permettre de recueillir des communications entre « 50k » et son propre supérieur, « Alang », que Red Bull n’avait jamais vu en personne.
Pour chacune de ces idées audacieuses, je consultai des collègues et des professionnels. Leur réponse fut toujours la même : l’utilisation d’une caméra cachée exige une formation spécialisée ; les logiciels que Red Bull souhaitait installer sur les ordinateurs de bureau laisseraient des traces traçables. Autrement dit, toutes ces méthodes présentaient un risque élevé de le faire repérer, puis de le faire tuer.
Nous optâmes finalement pour une méthode bien plus simple : pendant ses heures de travail, il utiliserait l’ordinateur de bureau pour se connecter à Signal et m’envoyer des messages et des documents, en activant la fonction « effacement automatique après lecture » avec un délai de cinq minutes afin de masquer ses traces. Parfois, pour se couvrir et éviter d’être découvert, il commença à m’appeler « Oncle », feignant de parler à un membre de sa famille.
Nous établissons également un code secret : l’un d’entre nous envoyait d’abord « Red », l’autre répondait « Bull », confirmant ainsi que le compte n’avait pas été usurpé. Red Bull trouva même un moyen de modifier le nom et l’icône de l’application Signal sur son ordinateur, la faisant ressembler à un raccourci vers un lecteur dur.
Il commença à m’envoyer en continu des photos, des captures d’écran et des vidéos : un tableau Excel et une photo d’un tableau blanc, sur lequel figuraient les progrès de son équipe, avec, à côté des pseudonymes de nombreux membres, des montants en dollars américains représentant les sommes escroquées ; un gong traditionnel chinois dressé dans le bureau, frappé chaque fois qu’un employé réussissait une escroquerie supérieure à 100 000 dollars ; page après page de conversations WhatsApp publiées dans le groupe interne du bureau, documentant les succès frauduleux de ses collègues et les réponses désespérées des victimes : « J’ai toujours rêvé d’avoir une petite amie comme vous, puis de me marier », « Pourquoi ne me répondez-vous plus ? », « Je prierai toujours pour votre mère », « S’il vous plaît, aidez-moi à retirer mon argent », « ??? », « 😭 ». Une vidéo montrait également une victime pleurant à chaudes larmes dans sa voiture après avoir perdu une somme à six chiffres ; elle avait envoyé cette vidéo à ses escrocs, peut-être dans l’espoir de susciter un sentiment de culpabilité, mais celle-ci avait été diffusée dans tout le bureau, devenant la risée générale.
Chaque employé devait faire un rapport quotidien sur ses performances : nombre de « premiers contacts » initiés, nombre de « contacts approfondis » menés — c’est-à-dire les échanges susceptibles de déboucher sur une escroquerie. Leurs discussions regorgeaient de jargon codé : « développer de nouveaux clients » désignait le fait de piéger de nouvelles cibles, tandis que « réinvestissement » désignait les victimes qui tombaient une deuxième fois dans le piège. Chaque équipe avait des objectifs de performance, généralement d’environ un million de dollars par mois. Les atteindre permettait aux employés de bénéficier de congés le week-end, de grignoter des collations au bureau, voire d’assister à des fêtes dans des clubs voisins. (Red Bull précisa que les patrons se retiraient alors dans des salles privées fermées par des rideaux.) En cas d’échec, les employés subissaient des reproches, des amendes et étaient contraints de travailler sept jours sur sept, sans repos.
Tableau blanc dans le bureau, listant les résultats des escroqueries, avec les pseudonymes des employés et les noms des équipes. Fourni par Red Bull
Chaque employé devait également publier un emploi du temps quotidien obligatoire — mais ce n’était pas la description de leur vie nocturne, passée sous des néons à envoyer des messages sur Facebook et Instagram. Il s’agissait plutôt de l’emploi du temps fictif de la riche femme célibataire qu’ils étaient censés incarner : 7 h « yoga et méditation », 9 h 30 « soins personnels et planification des vacances », 14 h 30 « rendez-vous chez le dentiste », 18 h « dîner et discussion avec maman ».
Parfois, lors d’appels vocaux, Red Bull me demandait d’activer la vidéo pour enregistrer mon écran, puis entrait à la cantine, feignant de parler à son « oncle », tout en filmant discrètement son environnement. J’avais l’impression de le suivre dans une visite guidée de ce bâtiment : le hall éclairé, les escaliers, et des rangées d’hommes d’Asie du Sud et d’Afrique, aux visages impassibles, faisant la queue pour recevoir leur repas. Une fois, il parvint même à filmer l’intérieur du bureau : une immense salle beige où l’on pouvait distinguer des rangées de bureaux ornés de drapeaux rouges, jaunes et verts, symbolisant les performances respectives des différentes équipes.
Quelques jours plus tard, nous renforçâmes notre couverture : je devins sa petite amie secrète, afin de justifier plus facilement son utilisation de Signal s’il était découvert. Nos échanges comportaient des émoticônes cœur, nous nous appelions « chéri(e) », et concluions systématiquement par « Je pense à toi ». Au fil du temps, nos conversations ressemblèrent presque à s’y méprendre aux arnaques amoureuses quotidiennes mises en scène par son équipe. Mais très vite, nous trouvâmes cette mascarade trop embarrassante et y renonçâmes.
Une autre fois, alors que je m’apprêtais à dormir, Red Bull m’envoya un message d’adieu particulièrement émouvant : « Bonne nuit ! 🌙 Repose-toi bien — tu as déjà beaucoup fait aujourd’hui. Vide ton esprit, et accueille demain avec une nouvelle clarté d’esprit et une force tranquille. »
Bien que le texte parût un peu guindé, je dus admettre que ce message inhabituellement attentionné m’avait profondément touché. En effet, depuis le début de nos échanges, j’avais été soumis à une pression énorme et avais à peine dormi.
Lors de notre appel du lendemain matin, Red Bull m’expliqua le rôle joué par des outils d’IA comme ChatGPT et DeepSeek dans les opérations frauduleuses du complexe : les employés étaient formés à l’utilisation de ces outils pour perfectionner leurs textes, doser leurs émotions et prodiguer sans fin des mots doux.
Sans hésitation, il m’avoua que le message de bonne nuit de la veille provenait directement de ChatGPT. « Tout le monde ici fait cela. C’est ainsi qu’on nous l’a appris », dit-il.
Je ne pus m’empêcher de sourire : une simple phrase chaleureuse, rédigée à l’autre bout du monde par un inconnu, suffisait à toucher profondément le cœur.
Du jeune villageois indien au lanceur d’alerte antifraude
Chaque jour, pendant les quelques minutes où Red Bull se rendait du dortoir au bureau, outre les questions de sécurité et les stratégies de collecte de preuves, je lui demandais comment il avait atterri dans ce complexe, et pourquoi il était si déterminé à en révéler les secrets. Il me raconta, au fil de brèves conversations ou de longs SMS, les vingt-trois années de sa vie.
Red Bull me dit être né dans un village isolé de la région contestée du Jammu-et-Cachemire, à la frontière indo-pakistanaise, dans une famille de huit enfants musulmans. Son père était enseignant, travaillait parfois comme ouvrier du bâtiment, et élevait des vaches avec sa femme pour produire et vendre du ghee afin de subvenir aux besoins familiaux.
Au début du XXIe siècle, alors que Red Bull était encore enfant, sa famille quittait régulièrement le village pour fuir les conflits intermittents entre l’armée indienne et les groupes armés soutenus par le Pakistan dans le nord du Cachemire. Les hommes musulmans de la région étaient parfois enrôlés de force pour combattre ou transporter des fournitures pour les groupes armés soutenus par le Pakistan, puis étiquetés comme « terroristes » et abattus par l’armée indienne.
Une fois le conflit apaisé, les parents de Red Bull l’envoyèrent vivre avec ses grands-parents à Rajouri, une ville située à quatre heures de route, dans l’espoir que ce garçon particulièrement intelligent et curieux y recevrait une meilleure éducation. Il me raconta que ses grands-parents étaient très stricts. Outre ses études, il devait couper du bois et porter de l’eau, et l’école se trouvait à six miles de chez lui, qu’il devait rejoindre à pied. Ses chaussures étaient usées, ses pieds couverts d’ampoules, et il utilisait une corde attachée à sa ceinture pour maintenir son pantalon.
Malgré tout, il conservait une forme d’optimisme obstiné. « Je me disais toujours : même si ce n’est pas possible aujourd’hui, tout ira mieux demain », écrivit-il dans un SMS.
À quinze ans, ses grands-parents le placèrent chez deux enseignants, qui l’employèrent comme domestique en échange de ses frais de scolarité. Il se levait chaque matin avant l’aube, nettoyait la maison avant le petit-déjeuner, lavait la vaisselle, puis allait à l’école.
Il se souvient d’un jour où, dans cette maison, il observait, fasciné, le fils aîné jouer à la dernière version du jeu FIFA sur un ordinateur — ce fut la première fois qu’il voyait un ordinateur. La seconde d’après, on le rabroua pour qu’il retourne à ses tâches. C’est à partir de ce moment qu’il développa une obsession pour les ordinateurs. « J’ai ressenti de la honte, le sentiment de ne pas être respecté, car je n’avais même pas le droit de toucher à cette machine », écrivit Red Bull. « Je me suis dit que, un jour, je serai le maître de cette machine. »
Après une humiliation particulièrement humiliante, Red Bull décida de fuir. Le lendemain matin, avant que la famille ne se réveille, il quitta la maison et se rendit en ville, où il trouva divers petits boulots : ménage, construction, moissonnage du riz. Pendant un temps, il alla même de porte en porte vendre des médicaments ayurvédiques. Le soir, il étudiait seul dans une petite chambre qu’il louait. En 2021, il réussit le concours d’entrée à l’Institut gouvernemental polytechnique du Cachemire, à Srinagar, la plus grande ville de la région, pour y suivre une formation en sciences informatiques.
Durant ses études universitaires, les hivers au Cachemire étaient particulièrement rigoureux, et il dormait dans une chambre dépourvue de literie convenable, souffrant souvent de la faim. Un ami lui apprit à créer des pages Facebook pour des entreprises ou à spéculer sur les pages Facebook comme le font certains promoteurs immobiliers. Il expérimenta sur les ordinateurs de l’université et gagna rapidement environ 200 dollars, avec lesquels il acheta un ordinateur portable Dell d’occasion — son bien le plus précieux, qui changea sa vie.
Après trois années d’études, de petits boulots et d’envois d’argent à sa famille, il obtint finalement son diplôme en génie informatique. Il me dit que c’était le premier diplôme de ce niveau obtenu par un habitant de son village. C’est également durant cette période qu’il développa une détermination obstinée, teintée d’une certaine colère : tracer sa propre voie, par ses propres moyens.
« Mes parents me disaient toujours d’être patient et fort ; leurs paroles m’ont donné une certaine force intérieure, mais ce combat reste le mien », écrivit-il. « Personne ne peut vraiment me comprendre, mais je n’ai jamais cessé de lutter contre mon destin. »
Un voyage d’embauche vers l’enfer
Peu après son diplôme, Red Bull gagnait déjà confortablement sa vie en créant des pages Facebook et des sites web, avec un salaire mensuel pouvant atteindre 1 000 dollars. Mais il nourrissait des ambitions plus grandes : travailler dans les domaines de l’intelligence artificielle ou de la biomédecine, ou devenir un « hacker éthique » spécialisé en cybersécurité. (Mr. Robot était sa série préférée.) Il rêvait d’étudier à l’étranger, mais ne pouvait pas en assumer les coûts, et sa demande de prêt étudiant fut rejetée.
Il décida donc de travailler un ou deux ans pour économiser. Un camarade de l’université lui parla d’un emploi intéressant au Laos. Red Bull entra en contact avec cet intermédiaire, qui se présentait sous le pseudonyme d’Ajaz et affirmait connaître un recruteur capable de lui trouver un poste de chef IT dans un bureau laotien, avec un salaire mensuel d’environ 1 700 dollars. Pour Red Bull, ce salaire alléchant signifiait qu’il pourrait peut-être ne travailler qu’un an avant de retourner à l’université.
Ajaz demanda à Red Bull de se rendre à Bangkok en avion, puis d’appeler le recruteur depuis l’aéroport. Red Bull monta dans l’avion, ignorant même le secteur d’activité de son futur employeur, ne sachant que son rôle serait d’aider à la gestion des ordinateurs. Il se souvient de l’excitation intense de son premier voyage à l’étranger, et, pendant le vol de nuit au-dessus de l’océan Indien, son esprit était rempli d’espoir pour l’avenir.
Le lendemain matin, à Bangkok, il appela le recruteur, un homme d’Afrique de l’Est, qui lui ordonna brièvement de prendre un bus de douze heures pour aller à Chiang Mai, puis un taxi jusqu’à la frontière laotienne. À son arrivée à la frontière, Red Bull dut prendre une photo de lui-même devant le bureau de l’immigration et l’envoyer au recruteur. Quelques minutes après avoir envoyé la photo, un fonctionnaire de l’immigration sortit, agita la photo qu’il avait reçue du recruteur et demanda à Red Bull 500 bahts (environ 15 dollars). Red Bull paya, le fonctionnaire tamponna son passeport, puis lui fit traverser la rivière Mékong à bord d’un bateau en attente. Ce bac traversa la rivière Mékong, au sud du point de jonction des frontières thaïlandaise, laotienne et birmane. C’était le Triangle d’or.
Une fois le bateau entré dans les eaux laotiennes, un jeune Chinois, de l’autre rive, lui montra la même photo. Sans un mot, il confisqua le passeport de Red Bull et le remit au fonctionnaire de l’immigration, accompagné de quelques yuans. Peu après, le passeport lui fut rendu, tamponné d’un visa.
Le Chinois glissa le passeport dans sa poche et demanda à Red Bull d’attendre l’intermédiaire d’Afrique de l’Est. Puis il s’éloigna, emportant le passeport de Red Bull.
Une heure plus tard, l’intermédiaire arriva dans une fourgonnette blanche et conduisit Red Bull à un hôtel du nord du Laos, où il passerait la nuit. Allongé sur le lit de la chambre vide, il ne pensait qu’à son entretien d’embauche officiel prévu le lendemain, oscillant entre anxiété et excitation. Il n’avait encore rien soupçonné.
Le lendemain matin, on le conduisit dans un bureau, une structure en béton gris plantée au milieu des montagnes verdoyantes du nord du Laos, entourée d’autres bâtiments monotones. Red Bull s’assit nerveusement à un bureau, tandis qu’un Chinois et un interprète lui faisaient passer des tests de frappe et d’anglais, qu’il réussit aisément. On lui annonça qu’il était recruté, puis on l’interrogea sur sa familiarité avec les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn.
Red Bull répondit avec enthousiasme à toutes les questions. Finalement, on lui demanda s’il comprenait bien la nature du travail qu’il allait effectuer. « Est-ce un poste de chef IT ? » demanda-t-il. La réponse fut catégorique, sans aucun euphémisme cette fois : il devait devenir un « escroc ».
Ce fut à ce moment précis que Red Bull comprit enfin sa situation, plongeant dans une terreur extrême. Le patron chinois lui ordonna de commencer immédiatement. Pour gagner du temps, il supplia qu’on lui accorde une nuit de repos avant de commencer. Le patron accepta.
Cette nuit-là, dans la chambre d’hôtel, Red Bull chercha frénétiquement sur Internet des informations sur les complexes d’escroquerie du Triangle d’or. Ce n’est qu’à ce moment qu’il réalisa pleinement la profondeur du piège dans lequel il était tombé : il était trop tard. Il découvrit des milliers d’Indiens comme lui, trompés de la même manière, emprisonnés sans passeport, sans aucune chance de s’échapper. Dans cette révélation nauséabonde, ses parents l’appelèrent en visioconférence pour lui demander s’il avait obtenu le poste de chef IT. Il réprima sa honte et son remords, affirma que c’était le cas, forçant un sourire et acceptant leurs félicitations.
Les drapeaux colorés placés dans chaque zone de travail représentent les performances frauduleuses de l’équipe. Fourni par Red Bull
Un gong traditionnel chinois dressé dans le bureau, frappé chaque fois qu’un employé réussit une escroquerie supérieure à 100 000 dollars. Fourni par Red Bull
Les jours suivants, il fut plongé dans le fonctionnement du réseau sans presque aucune formation préalable. Il apprit plus tard que ce complexe s’appelait le complexe d’escroquerie de Boshang. Il fut formé à la création de faux comptes, reçut des scénarios frauduleux, puis commença à travailler selon un horaire de nuit, envoyant manuellement des centaines de messages d’approche chaque soir afin de piéger de nouvelles victimes. Après le travail, il retournait à son lit superposé dans un dortoir de six personnes, encore plus petit que la chambre d’hôtel où il avait passé sa première nuit, avec des toilettes dans un coin.
Mais il dit qu’il décida dès le départ de reprendre le combat contre son destin. Il remarqua qu’il connaissait bien mieux les ordinateurs que la plupart de ses collègues, voire que ses patrons eux-mêmes, qui semblaient ne savoir utiliser que les réseaux sociaux, les outils d’IA et les cryptomonnaies. En quelques jours seulement, il commença à imaginer comment exploiter ses compétences techniques pour collecter discrètement des informations sur le complexe, puis les révéler d’une manière ou d’une autre.
Red Bull prit progressivement conscience qu’il n’y avait pratiquement aucun obstacle à la divulgation des secrets du complexe. Pendant les heures de travail, le chef confisquait les téléphones personnels des employés et les rangeait dans une boîte, interdisant strictement l’emport des appareils professionnels hors du bureau. En revanche, la surveillance exercée par le complexe sur les employés et leurs téléphones personnels était, de façon surprenante, très laxiste.
Selon Red Bull, les patrons semblaient principalement compter sur la peur et le désespoir pour contrôler ces victimes du trafic humain, et la plupart de ses collègues avaient apparemment perdu tout espoir de résistance. « Ils se disent que survivre est leur seul objectif, puis étouffent tout ce qui fait d’eux des êtres humains », écrivit Red Bull. « L’empathie, le sentiment de culpabilité, voire même le souvenir de qui ils étaient avant. »
Et ce qui lui permettait de conserver un espoir, c’était en partie le sentiment qu’il était différent des autres. « La plupart des gens ne possèdent ni ces compétences, ni ces outils, ni même cette force spirituelle pour résister de l’intérieur », écrivit-il. « Moi, je peux naviguer dans ce système, observer, recueillir des preuves, des noms, des scénarios, des tactiques, des liens. »
Pourtant, parfois, je ne parvenais toujours pas à comprendre ce qui avait donné à Red Bull le courage de me contacter, de risquer sa vie, plutôt que de simplement attendre la fin de son contrat. « Peut-être pour la justice, peut-être par sens moral », répondit-il. « Si Dieu existe, j’espère qu’il voit tout ce que je fais. S’il n’existe pas, au moins je sais que, dans cet endroit qui cherche à transformer les êtres humains en démons, j’ai préservé mon humanité. »
Dangers croissants, risques d’exposition et plans désespérés de fuite
Au fil du temps, les documents que Red Bull m’envoyait devenaient de plus en plus nombreux, et je sentais progressivement que le danger se rapprochait. Un jour, Red Bull me dit que son chef Amani l’avait interrogé, d’une voix calme mais menaçante, sur la raison pour laquelle il passait tant de temps à l’extérieur sans parvenir à « développer » beaucoup de nouveaux « clients ». Amani insinua même qu’une bonne raclée ou quelques décharges électriques pourraient améliorer son efficacité.
Presque simultanément, Red Bull m’annonça que de nouvelles caméras de surveillance avaient été installées dans le bureau, y compris au plafond devant et derrière son bureau. Je lui demandai immédiatement de cesser tout contact avec moi depuis le bureau, le risque étant désormais trop élevé. Mes rédacteurs arrivèrent à une conclusion encore plus ferme : je devais interrompre définitivement mes entretiens avec Red Bull jusqu’à ce qu’il soit libéré.
À ce stade, Red Bull m’avait déjà envoyé 25 scénarios et guides d’escroquerie, en anglais et en chinois. Ces documents analysaient le processus frauduleux dans un détail sans précédent : listes de formules d’approche ; conseils sur la façon de réagir lorsque la cible demande une vidéo-conférence, et comment gagner du temps jusqu’à ce que le modèle de vidéo deepfake soit prêt ; astuces pour critiquer les institutions financières trop prudentes, afin de désamorcer les alertes bancaires qui pourraient effrayer la victime.
Peut-être ces documents suffisaient-ils. J’obéis à la directive de mes rédacteurs et dis à Red Bull qu’il était temps de mettre fin à notre collaboration. « Très bien, ainsi soit-il », répondit-il, comme toujours, avec une promptitude exemplaire.
Une vidéo secrètement tournée lors d’un appel Signal, montrant l’intérieur de la cantine du complexe d’escroquerie de Boshang. Red Bull dit que la nourriture y avait « un goût chimique étrange ». Les employés qui commettaient des infractions, même mineures comme arriver en retard au travail ou ne pas répondre à l’appel dans le dortoir, étaient interdits d’accès à la cantine.
Je lui dis qu’il devait désormais faire tout ce qui était en son pouvoir pour terminer en toute sécurité les six mois restants de son contrat, et que nous reprendrions contact une fois qu’il serait libre. Mais Red Bull, une fois encore, avait déjà pensé plus loin. Il m’expliqua que s’il devait mettre fin à nos entretiens à ce stade, il partirait immédiatement.
Il me dévoila un plan d’évasion qu’il avait mûri depuis longtemps : falsifier une lettre de la police indienne, affirmant qu’il était sous enquête dans la région du Jammu-et-Cachemire. Il dirait à son supérieur qu’en cas de refus, non seulement lui et sa famille seraient en grand danger, mais que le complexe entier en souffrirait également. Il supplierait son patron de lui accorder deux semaines pour régler cette affaire, promettant de revenir aussitôt après. Il pensait que son patron pourrait croire cette histoire et le laisser partir.
Je trouvai ce plan totalement irréaliste et le lui dis franchement : je le prévins que les gestionnaires du complexe pourraient découvrir la falsification du document et le punir sévèrement. Mais après avoir tenté de le dissuader de plusieurs autres projets dangereux, il semblait particulièrement déterminé à mener celui-ci à bien. Je lui demandai d’attendre, ajoutant que j’essaierais de le mettre en contact avec des personnes familières des stratégies d’évasion depuis ces complexes. Par exemple, je connaissais un militant d’Asie du Sud-Est, que je ne nommerai que « W », expérimenté dans l’aide aux réfugiés politiques fuyant la région.
Au moment précis où il entrait dans le hall du bureau, Red Bull bascula soudainement en mode de couverture. « Ne vous inquiétez pas, oncle, tout va bien », dit-il en passant devant un gardien. « Tout ira bien, d’accord ? » Puis il raccrocha.
Au cours de nos appels réguliers, Red Bull évoqua également une autre voie potentielle vers la liberté : s’il pouvait réunir environ 3 400 dollars, il pourrait racheter sa liberté et rentrer chez lui. Il ne lui restait plus qu’à trouver un moyen d’obtenir cette somme.
Des pensées contradictoires se bousculèrent dans mon esprit. D’abord, un élan d’espoir pour Red Bull, le désir de l’aider à payer cette rançon. Mais aussitôt, je pris conscience que Wired ne pourrait jamais, sous aucun prétexte, verser de l’argent à un informateur, encore moins payer une rançon à un réseau criminel de traite des êtres humains. Une telle action violerait les principes éthiques du journalisme. Verser de l’argent à un informateur est généralement considéré comme un acte de corruption créant un conflit d’intérêts, et ouvrant la porte à un précédent impardonnable. Je partageai ces réflexions avec Red Bull, qui répondit rapidement qu’il « comprenait parfaitement » et qu’il n’avait jamais demandé à moi ou à Wired de payer cette somme.
Pourtant, même cette proposition de rançon planta en moi une idée sombre, persistante : et si Red Bull me trompait ? Initialement, après avoir vu suffisamment de preuves attestant qu’il était bien la personne qu’il prétendait être — une victime réelle emprisonnée dans un terrifiant complexe d’escroquerie laotien —, j’avais déposé mes doutes initiaux. Or, après près de deux semaines de collaboration, cette possibilité troublante me hantait à nouveau : s’il était bien un employé interne du complexe, mais que tout cela n’était qu’une vaste escroquerie depuis le début ? À cette pensée, j’eus l’impression d’avoir trahi toute la confiance qu’il m’avait accordée.
Je décidai de mettre ce doute de côté, tout en reconnaissant qu’il pouvait avoir des intentions cachées, mais en choisissant surtout de croire à sa sincérité initiale.
Dans le même temps, quelques jours plus tard, il revint sur l’idée de falsifier des documents, et je répétai mon conseil de patienter jusqu’à l’arrivée de personnes comme W, plutôt que de tenter ce plan risqué. Mais je sentais que sa détermination ne faisait que croître. « Je n’ai pas d’autre choix », dit-il. « Je verrai bien ce qui se passe. »
Le plan éventé, la capture, la rançon et les aveux dans le désespoir
Quelques jours plus tard, un samedi après-midi, je reçus inopinément un courriel provenant de l’adresse Proton Mail que Red Bull avait utilisée pour me contacter initialement — une adresse qu’il n’avait plus utilisée depuis notre passage à Signal. Comme le premier courriel, celui-ci n’avait pas de sujet.
Je cliquai dessus, et une vague de terreur me submergea, paralysant mon esprit.
« Ils m’ont attrapé, ils ont pris tout mon téléphone », écrivait-il. « Ils m’ont battu, et maintenant ils pourraient me tuer. »
Red Bull avait mis en œuvre son plan de falsification de la lettre de la police indienne, et le pire semblait s’être produit.
Je réprimai ma panique et réfléchis rapidement à toutes les possibilités. J’envoyai des SMS à mes rédacteurs et à W, espérant qu’ils auraient une idée pour m’aider. Quinze minutes après l’envoi du premier courriel, je reçus un second message de Red Bull, plus cohérent que le précédent : « Je suis coincé, sans issue. Ils ont pris mon téléphone personnel et ma pièce d’identité », écrivait-il. « Si vous avez un moyen quelconque de m’aider, faites-le. »
Dans le même temps, W me répondit sur Signal. Nous échangeâmes rapidement par téléphone, essayant de déterminer ce que nous pourrions faire pour augmenter les chances de survie de Red Bull. Je ne savais pas comment Red Bull avait envoyé ce courriel, mais W m’avertit que lui répondre serait extrêmement dangereux. Son patron savait déjà qu’il leur avait menti pour s’enfuir. Mais pour l’instant, ils ignoraient encore qu’il était en contact avec un journaliste pour révéler les secrets du complexe.
S’ils découvraient cette vérité, ils le tueraient sans aucun doute. « Leur méthode serait extrêmement cruelle », dit W. « Il n’a aucune chance de sortir vivant de cet endroit. » Il me conseilla d’attendre que Red Bull me donne plus de détails sur sa situation et sur la manière sûre de communiquer avant d’agir.
Après une attente angoissante de 24 heures, je reçus enfin un autre courriel de Red Bull, long et désordonné, rédigé dans un état de détresse émotionnelle extrême.
« Hier soir, ils m’ont battu, je n’ai rien mangé, ils ont bloqué ma carte et confisqué mon téléphone personnel et tous mes effets. Aujourd’hui, ils décideront de mon sort. Le chef d’origine indienne et tous les autres étaient assis devant moi, me demandant si je savais qui ils étaient, puis m’ont à nouveau battu avant de me ramener au bureau. Aujourd’hui, je dois avouer que tout ce que j’ai fait est faux, que j’ai commis une erreur. Je ne peux pas m’échapper d’ici, je n’ai pas d’argent, je ne peux même pas franchir la porte. Je vous écris depuis l’ordinateur du bureau. Si vous avez un moyen quelconque, envoyez-moi un courriel, je le consulterai. Dites à W de me contacter par courriel. Ils me torturent, et après m’avoir ramené au bureau, je ne peux utiliser que l’ordinateur du bureau. Bonne nuit. »
Je n’eus pas le temps de répondre à ce courriel qu’un message Signal apparut : « Red. »
« Bull », répondis-je.
Il me répondit presque immédiatement, cette fois de manière très concise : il était détenu dans une pièce, et ses ravisseurs exigeaient qu’il trouve 20 000 yuans (environ 2 800 dollars) pour être libéré.
Dans cette crise vitale, je ne pus m’empêcher de penser que cela pouvait être la conclusion finale de la possible escroquerie que j’avais redoutée : attirer l’attention d’un journaliste, le faire entrer dans le piège, le rendre responsable de la sécurité d’un informateur, puis exiger qu’il paie une rançon pour le sauver.
Quoi qu’il en soit, mes rédacteurs m’avaient clairement indiqué que ni Wired, ni moi personnellement, ne pouvions verser de rançon à Red Bull ou à ses geôliers. En réalité, ils étaient plus sceptiques que jamais quant à la véracité de son histoire. Pourtant, je restais convaincu que ce cauchemar était malheureusement bien réel.
Red Bull semblait avoir récupéré son téléphone, probablement pour qu’il puisse contacter quelqu’un afin de lever la rançon. Mais je jugeai trop risqué de l’appeler directement. Je lui envoyai un SMS, lui suggérant d’essayer de contacter W pour voir s’il pouvait l’aider à s’échapper. W avait une grande expérience dans ce domaine, et s’il était surveillé, il serait moins dangereux pour lui d’être surpris en train de parler à un militant qu’à un journaliste.
Je dis également à Red Bull que, bien que je fusse profondément affecté par tout ce qu’il endurait, je ne pouvais pas payer sa rançon, tout comme je n’avais pas pu payer sa libération anticipée.
« Très bien », écrivit Red Bull. « Je comprends. » Il me demanda de dire à W de le contacter, et je promis de le faire.
Je le vis régler la fonction « effacement automatique après lecture » de Signal sur cinq secondes seulement — une mesure qui témoignait clairement de son extrême crainte d’être étroitement surveillé.
Il envoya un émoticône « pouce levé », puis le message disparut.
Dans les jours suivants, je contactai l’un après l’autre toutes les personnes que je pensais capables d’aider Red Bull, y compris celles qui auraient pu éventuellement verser la rançon : Erin West, W, et le dirigeant de l’organisation à but non lucratif de W. Mais tous refusèrent, soit par crainte d’alimenter le commerce de la traite des êtres humains dans les complexes, soit parce qu’ils doutaient de la véracité de l’histoire de Red Bull, soit pour les deux raisons à la fois.
Bien que West eût manifesté un grand enthousiasme lorsque Red Bull s’était présenté initialement, elle déclara à présent que cela ressemblait fortement aux escroqueries de traite des êtres humains qu’elle avait déjà entendues ailleurs : des victimes fictives réclamant des rançons factices. W eut plusieurs appels vocaux Signal avec Red Bull, mais fut déstabilisé par son état de panique extrême, et trouva suspecte sa demande pressante de versement de rançon (avec la promesse de remboursement ultérieur). « Cela ressemble à l’arnaque classique : “Donnez-moi un bitcoin, je vous en rendrai deux” », me dit-il plus tard.
Pourtant, je restais convaincu que j’avais la responsabilité de croire Red Bull, de supposer que son récit était authentique, et de faire tout ce qui était en mon pouvoir, dans les limites de l’éthique journalistique, pour l’aider à s’échapper.
Le troisième jour de sa captivité et de la demande de rançon, la situation sembla légèrement évoluer. Je sentis clairement que la surveillance exercée sur lui s’était relâchée, peut-être parce que ses ravisseurs commençaient à perdre patience. Je décidai de prendre le risque d’un appel téléphonique. « La situation n’est pas bonne », dit-il d’une voix douce, tendue contre le microphone de son téléphone, avec son ton habituel de désinvolture. Il me dit avoir de la fièvre, avoir été battu à plusieurs reprises, giflé, et frappé du pied, et avoir été contraint d’avouer avoir falsifié la lettre de la police indienne. Une fois, son patron avait versé une poudre blanche dans un verre d’eau et l’avait forcé à la boire. Après avoir bu, il s’était senti excessivement bavard et confiant, mais des plaques rouges étaient rapidement apparues sur sa peau. Il ajouta qu’il était parfois renvoyé dans son dortoir pour dormir, mais qu’il n’avait rien mangé depuis plusieurs jours et qu’on lui avait coupé l’eau depuis longtemps.
Il avait écrit à toutes les ambassades et consulats indiens d’Asie du Sud-Est, mais aucun n’avait répondu. « Personne ne viendra m’aider, je ne sais pas pourquoi », dit-il. Quelques minutes après le début de l’appel, sa voix se brisa, et des sanglots étouffés retentirent — c’était la première fois que j’entendais une note d’auto-apitoiement dans sa voix.
Mais il prit ensuite une profonde inspiration et se reprit rapidement. « J’ai envie de pleurer », dit-il, « mais je vais d’abord voir comment les choses évoluent. »
Le quatrième jour après sa tentative d’évasion avortée et la demande de rançon, Red Bull m’envoya un SMS indiquant un changement dans la situation du complexe. Tout était anormalement silencieux, et personne ne l’appelait au bureau. Après avoir interrogé plusieurs collègues, il apprit qu’une rumeur circulait : la police laotienne préparait une descente dans le complexe. Son patron chinois avait reçu des informations internes et avait commencé à agir discrètement.
Le lendemain, la rumeur de la descente policière persistait, et Red Bull reçut un message encourageant de l’ambassade indienne au Laos : « Veuillez fournir une copie de votre passeport et de votre carte professionnelle », écrivait-on. « L’ambassade prendra les mesures nécessaires pour organiser votre sauvetage. »
Le salut semblait à portée de main. Mais les jours suivants passèrent sans aucune suite. L’ambassade cessa de répondre aux messages de Red Bull. Un soir tard, j’essayai plusieurs fois avant de réussir à joindre un fonctionnaire de l’ambassade indienne. Il semblait totalement ignorant de la personne dont nous parlions, puis répéta la formule vague du gouvernement indien sur la volonté d’intervenir, avant de raccrocher.
Les jours passaient, le gouvernement indien ne donnait aucune réponse claire, la descente de police ne se produisait pas, et personne ne voulait payer sa rançon. Red Bull semblait progressivement basculer dans le fatalisme. Un matin, je reçus une série de messages de sa part, comme des aveux, comme s’il craignait de mourir dans sa cellule de détention et voulait purifier ses péchés.
« Je voudrais être honnête sur un point. Lorsque j’ai pris contact avec vous, j’ai dit que je n’avais jamais escroqué personne, ce qui n’est pas entièrement vrai », écrivit-il. « La vérité est que mon patron chinois m’a forcé à impliquer deux personnes dans la fraude. Je n’ai pas agi de mon plein gré et j’en éprouve chaque jour un profond sentiment de culpabilité. C’est pourquoi je veux aujourd’hui vous révéler toute la vérité. »
Par la suite, il me fournit davantage de détails sur ces deux victimes. Il avait escroqué 504 dollars à l’une d’elles, et environ 11 000 dollars à l’autre. Il me donna les noms des deux personnes. J’essayai de les contacter, mais ne parvins pas à localiser l’une d’elles, et l’autre ne répondit jamais. Selon le système d’incitation du complexe, Red Bull aurait dû percevoir une commission sur les 11 000 dollars escroqués. Mais il affirma n’avoir jamais reçu aucune récompense, hormis son maigre salaire de base.
Plus tard, je revis la photo du tableau blanc du bureau que Red Bull m’avait envoyée plus tôt. On y lisait clairement son nom chinois attribué par le complexe, « Ma Chao », avec à côté le montant de 504 dollars. J’avais complètement ignoré ce détail à l’époque, alors qu’il ne l’avait jamais cherché à cacher.
« Je vous confie ma propre histoire, dans toute sa vérité », écrivit Red Bull à la fin de ses aveux. « Voilà la vérité entière. »
Dix jours plus tard, dans un état de quasi-stupéfaction, Red Bull m’informa que lui et ses collègues avaient reçu l’ordre de faire leurs bagages. Les ordinateurs du bureau furent emballés et transférés dans les dortoirs. Tous les employés devaient déménager dans un nouveau bâtiment situé à quelques centaines de mètres, et leur fut ordonné de continuer à travailler dans ces dortoirs temporaires, plutôt que de revenir au bureau. Selon la rumeur, la descente policière était imminente.
Red Bull dit qu’il avait vécu comme un chien durant cette période, rejeté par ses collègues : sans couverture, dormant parfois par terre, ne recevant à manger que lorsque quelqu’un s’en souvenait, et souvent des restes avariés. Il avait perdu beaucoup de poids, souffrait de courbatures généralisées, avait de la fièvre et se sentait comme grippé.
Pourtant, Red Bull ne renonça pas, cherchant toujours à recueillir davantage de preuves.
Pendant l’arrêt des activités du bureau, l’utilisation des équipements de travail dans les dortoirs fut autorisée. La relâche de la sécurité du complexe permit à Red Bull de réaliser que c’était une opportunité. Un jour, profitant du sommeil d’un de ses colocataires, il trouva le téléphone professionnel de ce dernier.
Il avait déjà vu ce colocataire taper son mot de passe par-derrière, et put donc déverrouiller rapidement le téléphone. Ensuite, Red Bull utilisa la fonction « appareil associé » de WhatsApp pour lier son propre téléphone personnel à ce téléphone professionnel, lui permettant ainsi d’accéder aux communications internes du complexe. Il utilisa cette autorisation pour enregistrer l’écran, parcourant méticuleusement des mois de conversations internes, ainsi que toutes les captures d’écran des échanges avec les victimes publiées par ses collègues.
Un autre jour, il trouva dans un autre dortoir son propre téléphone professionnel, qu’il n’avait pas touché depuis sa tentative d’évasion avortée. Il utilisa à nouveau la fonction d’association WhatsApp pour permettre à
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News