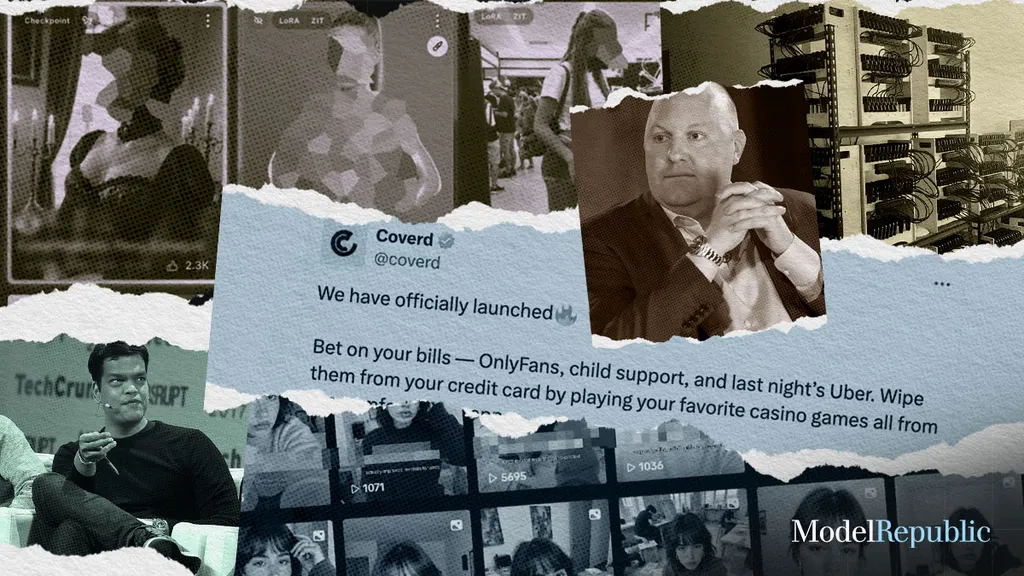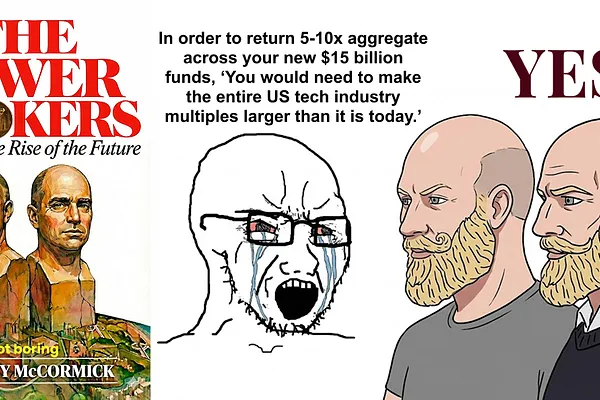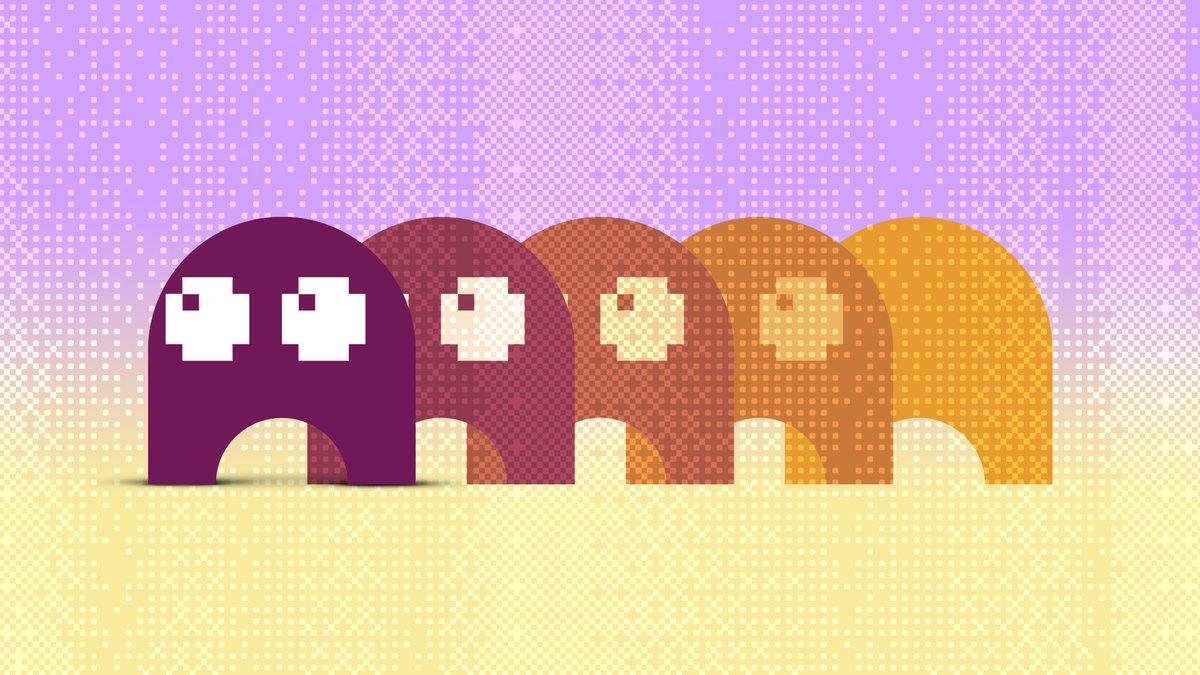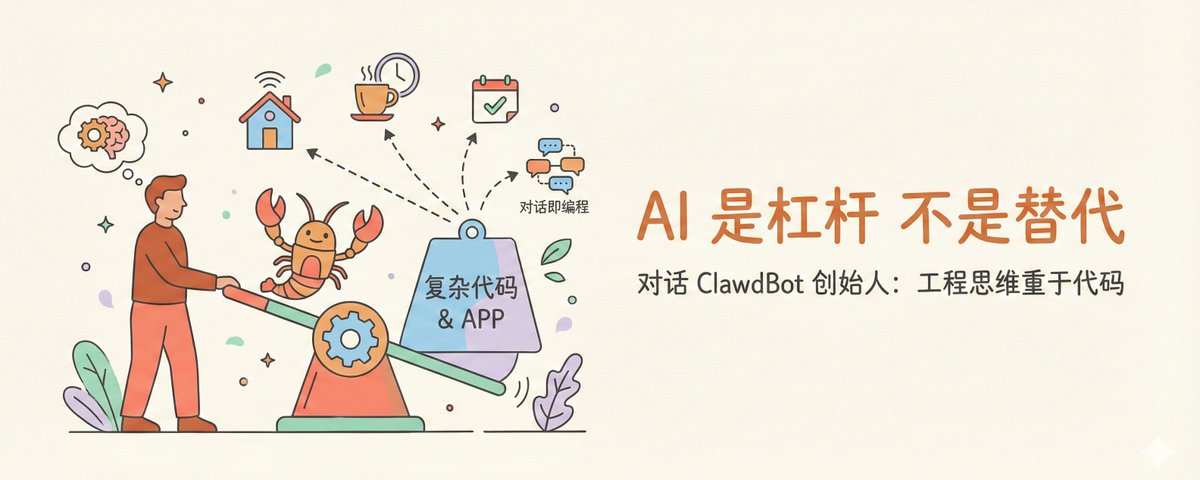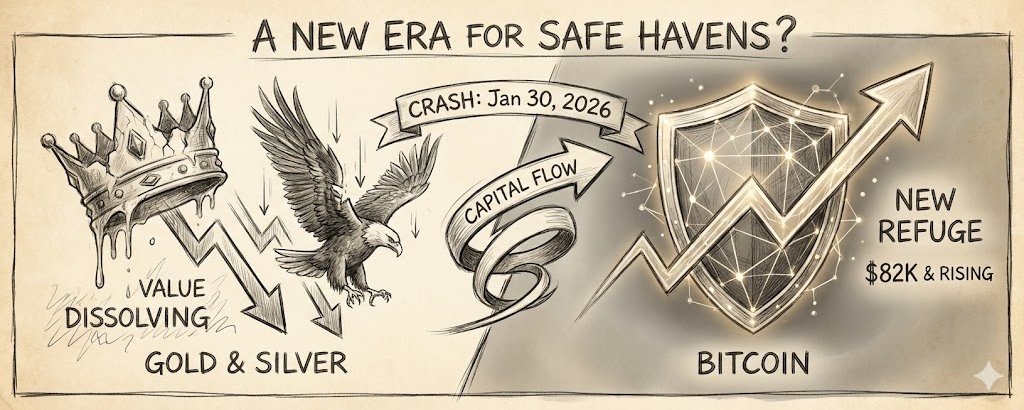a16z soutient : les ambitions des hackers cryptographiques à financer la création d'une nation
TechFlow SélectionTechFlow Sélection

a16z soutient : les ambitions des hackers cryptographiques à financer la création d'une nation
Les États numériques ne souhaitent pas seulement contraindre les gouvernements existants à se soumettre aux entreprises en leur permettant d'agir à leur guise, mais aspirent également à remplacer les gouvernements par des entreprises.
Rédaction : Gabriel Gatehouse
Traduction : BitpushNews Shawn
Quand vous pensez à l'élection présidentielle américaine à venir et aux troubles politiques futurs, avez-vous parfois le sentiment que la démocratie est en crise ? Un groupe d'entrepreneurs technologiques financés par de puissantes fortunes de la Silicon Valley partage ce malaise.
Imaginez pouvoir choisir votre nationalité comme on choisit un abonnement à une salle de sport. Voilà la vision du futur proposée par Balaji Srinivasan. Balaji — qui, comme Madonna, n'a besoin que d'un prénom — est une véritable « rock star » du monde des cryptomonnaies. Entrepreneur et capital-risqueur, il est convaincu que presque toutes les fonctions exercées aujourd'hui par les gouvernements pourraient être mieux remplies par la technologie.
L'automne dernier, j'ai assisté à Amsterdam, dans une grande salle de conférence en banlieue, à l'exposé de Balaji. Marchant lentement sur scène, il demandait : « Nous pouvons créer des entreprises comme Google ; nous pouvons bâtir de nouvelles communautés comme Facebook ; nous pouvons inventer de nouvelles monnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum ; alors, pourquoi ne pas fonder de nouveaux pays ? » Vêtu d’un costume gris un peu ample et d’une cravate desserrée, il ressemblait moins à une rock star qu’à un cadre moyen du service comptabilité. Ne vous y trompez pas : ancien associé de la puissante firme de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z), il bénéficie d’un soutien financier considérable.
La Silicon Valley adore le mot « disruption ». Pendant des années, les startups technologiques ont bouleversé les médias traditionnels ; elles s’attaquent désormais à l’éducation, à la finance, aux voyages spatiaux, etc. Balaji explique au public : « Imaginez des milliers de startups remplaçant chacune une institution traditionnelle. Elles coexistent d’abord avec les systèmes existants, attirent progressivement les utilisateurs, gagnent en puissance, jusqu’à devenir dominantes. »
Si les startups peuvent remplacer ces institutions, raisonne Balaji, pourquoi ne pourraient-elles pas remplacer les États eux-mêmes ? Il appelle cela un « État-réseau » (Network State) : une startup nation. Voici comment cela fonctionnerait : tout d’abord, une communauté se forme en ligne autour de valeurs ou d’intérêts communs. Ensuite, cette communauté acquiert un territoire et devient un État physique doté de ses propres lois. Ces États coexisteront puis remplaceront progressivement les nations souveraines traditionnelles. Vous choisirez votre nationalité comme on choisit son fournisseur d’accès internet, devenant citoyen du réseau qui vous correspond.
Le fait que les entreprises exercent une influence excessive sur les affaires publiques n’est pas nouveau. L’expression « république bananière » vient de la United Fruit Company, une entreprise américaine qui, pendant plusieurs décennies à partir des années 1930, a pratiquement gouverné le Guatemala. Possédant la majeure partie des terres, elle contrôlait aussi les chemins de fer, les services postaux et le télégraphe. Quand le gouvernement guatémaltèque a tenté de lui résister, la CIA a aidé United Fruit à organiser un coup d’État.
Mais l’ambition du mouvement des États-réseaux semble plus vaste encore. Il ne s’agit pas seulement de soumettre les gouvernements existants aux entreprises, mais bien de remplacer complètement les gouvernements par des entreprises.
Certains voient dans l’idée d’État-réseau une forme de néocolonialisme, où des dirigeants d’entreprise, au service des actionnaires, remplaceraient les leaders élus. D’autres y voient une réponse aux régulations étouffantes des démocraties occidentales. Une simple fantaisie de geeks ? En réalité, certains embryons d’États-réseaux existent déjà.

Lors de la conférence d’Amsterdam, plusieurs entrepreneurs technologiques ont présenté ces « sociétés-startups ». Parmi eux, Cabin, une ville-réseau moderne inspirée du village, présente aux États-Unis et au Portugal ; ou encore Culdesac, une communauté en Arizona conçue spécifiquement pour le travail à distance.
Le concept d’État-réseau de Balaji s’appuie sur celui des « villes-charters » (Charter Cities) : des zones économiques spéciales, semblables à des ports francs. Plusieurs projets de ce type sont en cours dans le monde entier, notamment au Nigeria et en Zambie. Récemment, lors d’un rassemblement à Las Vegas, Donald Trump a promis que, s’il était élu en novembre, il mettrait à disposition des terres fédérales dans le Nevada pour créer de nouvelles zones caractérisées par des impôts et des régulations extrêmement faibles, afin d’attirer de nouvelles industries, construire des logements abordables et créer des emplois. Selon lui, ce plan relancera « l’esprit pionnier et le rêve américain ».
Culdesac et Cabin ressemblent davantage à des communautés en ligne ayant acquis un territoire. Próspera, située sur la côte du Honduras, est différente : elle se décrit comme une « ville privée » au service des entrepreneurs, promouvant la science de la longévité — offrant des thérapies génétiques non réglementées pour ralentir le vieillissement.
Próspera est gérée par une entreprise à but lucratif enregistrée au Delaware, aux États-Unis. Elle avait obtenu sous un régime spécial du précédent gouvernement hondurien le droit de légiférer elle-même. La présidente actuelle, Xiomara Castro, souhaite supprimer ces privilèges et a commencé à retirer certaines exemptions. En réponse, Próspera a intenté une procédure contre le Honduras pour 10,8 milliards de dollars.
Une cité cryptographique au libre marché
Pendant la journée de présentations, un jeune homme en sweat à capuche gris monte sur scène : Dryden Brown. Il annonce vouloir construire, quelque part sur la côte méditerranéenne, une nouvelle nation-ville qui ne serait pas dirigée par une bureaucratie étatique, mais par la blockchain — la technologie sous-jacente aux cryptomonnaies. Ses principes fondateurs seraient des notions telles que « vitalité » et « vertu héroïque ». Il l’appelle « Praxis », mot issu du grec ancien signifiant « action ». Les premiers citoyens de cette nouvelle nation pourraient emménager dès 2026, selon lui.

Il reste vague sur les détails. Où exactement ? Qui construira les infrastructures ? Qui gérera la ville ? Sur scène, Dryden Brown manipule une télécommande et projette une diapositive indiquant que Praxis bénéficie du soutien de centaines de milliards de dollars de capitaux.
Pour l’instant, la « communauté Praxis » existe surtout en ligne. Vous pouvez postuler à la citoyenneté sur leur site web. Mais on ignore encore qui sont vraiment ces citoyens. Dryden projette une autre diapositive : un mème de la grenouille « Pepe », un personnage de dessin animé triste devenu, durant la campagne de Trump en 2016, le symbole de l’« alt-right ».
Dans cet univers de niche des startups-nations, Praxis est connu pour son caractère « avant-gardiste ». Ils organisent des soirées légendaires : dîners aux chandelles dans d’immenses lofts new-yorkais, où des programmeurs introvertis côtoient des mannequins branchés et des figures du « Dark Enlightenment » — dont Curtis Yarvin, un blogueur favorable à un futur autoritaire gouverné par des « monarques » corporatistes. On qualifie parfois ses idées de fascistes, ce qu’il rejette. Ces événements exigent des accords de confidentialité, et les journalistes n’y sont généralement pas les bienvenus.
À la fin de son discours, j’aborde Dryden Brown. Il est méfiant, distant, mais me donne tout de même son numéro de téléphone. Je lui envoie plusieurs messages par la suite, sans réponse. Environ six mois plus tard, je vois sur X une notification intrigante : « Lancement du magazine Praxis. Demain soir. Photocopiez votre page préférée. » Aucun horaire ni lieu précis n’est indiqué, juste un lien pour postuler. Je postule, mais n’obtiens aucune réponse. Le lendemain matin, je renvoie un message à Dryden Brown. À ma surprise, il répond aussitôt : « 22 heures, Ella Funt. »
Ella Funt est un bar et club privé à Manhattan, anciennement Club 82, lieu mythique de la communauté LGBTQ+ new-yorkaise. Dans les années 1950, des écrivains et artistes y buvaient des cocktails servis par des femmes en smoking, avant d’assister à des spectacles de drag queens en sous-sol. Ce soir-là, il accueille une fête privée pour ceux qui veulent fonder de nouveaux pays — et j’ai été invité. Mais je suis alors en Utah, à 3 200 km de là. Si je veux assister à la soirée, je dois prendre un avion immédiatement.
J’arrive même parmi les premiers. La salle est presque vide, seuls quelques membres de Praxis disposent des magazines au bar. J’en feuillette un : papier épais et luxueux, publicités aléatoires : parfum, arme imprimée en 3D, publicité pour du lait. Comme la grenouille « Pepe », le lait est un mème internet. Dans les cercles de l’« alt-right », publier une bouteille de lait symbolise le suprémacisme blanc.

Le magazine encourage les lecteurs à « photocopier les pages et les coller partout dans votre ville » — une analogie avec la propagation virale en ligne. Une photocopieuse a même été installée spécialement dans le bar.
Un groupe de jeunes entre, certains en bottes de cow-boy. Pourtant, ils n’ont pas l’air d’authentiques adeptes du plein air. Je discute avec l’un d’eux, qui se présente comme Zack, un « cowboy crypto » originaire de Milton Keynes (coiffé d’un chapeau de cow-boy en cuir).
« Je représente un peu l’esprit sauvage de l’Ouest américain », dit-il. « Je sens que nous sommes à la frontière du nouveau monde. »
Beaucoup associent les cryptomonnaies à des escroqueries : des monnaies numériques très volatiles dont la valeur peut s’effondrer du jour au lendemain. Mais dans l’univers des États-réseaux, on adore les cryptomonnaies. On les voit comme la monnaie de demain — une monnaie que les gouvernements ne pourront pas contrôler.
Je discute ensuite avec un autre participant qui se fait appeler Az. Je lui demande son nom de famille. Il sourit : « Mandias. » Une référence au poème « Ozymandias » de Shelley : « Roi des rois, Ozymandias ». L’anonymat fait partie intégrante de l’esprit crypto. J’ai l’impression que personne ici ne me dit son vrai nom.
Az vient du Bangladesh, mais a grandi dans le Queens, à New York. Il a fondé une startup technologique. Selon lui, tout comme l’imprimerie a contribué il y a 500 ans à la chute du système féodal européen, les nouvelles technologies — cryptomonnaies, blockchain, intelligence artificielle — entraîneront la chute des États-nations démocratiques.
« Bien sûr, la démocratie est formidable », dit-il. « Mais le meilleur dirigeant est un dictateur moral. Certains l’appellent un “philosophe-roi”. »
La montée des monarchies d’entreprise ?
Az exprime son excitation à l’idée de « se tenir au bord de la Renaissance à venir ». Avant celle-ci, il prévoit toutefois une « lutte » contre les nouvelles technologies — une sorte de mouvement luddite — qui détruira des millions d’emplois et monopolisera l’économie mondiale. Selon lui, les luddites finiront par perdre.
Il prédit que la transition vers ce qu’il appelle la « prochaine étape » de l’évolution humaine — l’ère des États-réseaux — sera violente et « darwinienne ».
Cette perspective ne l’inquiète pas. Au contraire, il semble enthousiaste à l’idée que de nouveaux rois émergeront des ruines de la démocratie : des dictateurs d’entreprise régneront sur leurs empires numériques.
Je vais au bar commander un verre. Là, je rencontre deux personnes qui ne ressemblent pas aux habitués du milieu crypto. Eyiza est gérante d’un autre club voisin, et son amie Dylan est étudiante. Elles semblent avoir été invitées pour ajouter du charme à la soirée — après tout, cette fête est essentiellement un rassemblement de frères crypto et de geeks informatiques. Pourtant, elles ont leurs propres opinions sur tout cela.
« Et si vous n’avez pas assez d’infirmiers ou d’enseignants ? » demande Dylan. « Construire une ville sans aucun gouvernement, c’est irréaliste. » Eyiza trouve l’ensemble du projet dystopique. « Nous voulions voir à quoi ressemble un vrai rassemblement de secte », dit-elle à moitié sérieusement.
C’est alors que Dryden Brown arrive, cofondateur de Praxis. Il sort fumer, je le suis. Il m’explique que le magazine Praxis est une manière de présenter la nouvelle culture qu’il souhaite incarner. Praxis, dit-il, incarne « l’esprit pionnier » et la « vertu héroïque ».
Je doute que Dryden survive longtemps dans un véritable Far West. Il semble épuisé par tout cela. Je voudrais lui poser des questions directes sur le projet d’État-réseau : qui seront les citoyens de ce nouveau monde ? Qui le gouvernera ? Que dire de ces mèmes d’extrême droite ? Et puis, la question de Dylan : qui soignera les patients à l’hôpital ?
Mais nous sommes constamment interrompus par de nouveaux arrivants. Dryden Brown m’invite à visiter le « consulat de Praxis » le lendemain. Nous nous saluons et rentrons. La fête devient de plus en plus animée. Eyiza, Dylan et leurs amis, qui ressemblent à des mannequins, grimpent sur la photocopieuse — non pas pour copier des pages du magazine, mais des parties de leurs corps. Je prends un exemplaire du magazine et je pars.
De retour dans mon petit Airbnb au-dessus de Chinatown, je feuillette le magazine. Outre les mèmes suprémacistes et les publicités pour armes, un QR code apparaît. Il redirige vers un court-métrage : une diatribe de 20 minutes contre le vide de la vie moderne, une élégie pour un monde perdu de hiérarchies et d’héroïsme.
Quel est le véritable sens de tout cela ?
« Tu as le divertissement, tu es satisfait », dit une voix off. « Tu sembles productif. Mais tu n’es pas grand. » La voix parle d’« algorithmes qui te font haïr toi-même et ta propre civilisation ».
Dans la vidéo, un personnage animé pointe directement une arme à feu vers le spectateur.
« Les médias contemporains prétendent que toute idéal est fasciste », poursuit la voix off. « Tout ce qui implique une conviction serait fasciste. »
S’agit-il d’inviter à accepter l’étiquette de fascisme ? Ce mouvement semble nostalgique d’une culture occidentale spécifique — un monde nietzschéen où le plus fort domine, où le chaos et la destruction engendrent la grandeur.
Le lendemain, je rends visite au « consulat de Praxis » — un immense loft sur Broadway. Comme prévu, les étagères regorgent d’œuvres de Nietzsche, de biographies de Napoléon, et d’un livre intitulé *The Dictator’s Handbook*. J’attends un moment, mais Dryden Brown ne se montre pas.
En partant, je me demande encore ce que j’ai vu la veille : était-ce un aperçu du futur ? Un monde où des nations comme les États-Unis ou le Royaume-Uni se fragmenteraient en un réseau de sociétés-entreprises, où vous pourriez choisir votre citoyenneté ? Ou bien Dryden Brown et ses amis jouent-ils simplement à la révolution « alt-right », faisant semblant de renverser le système pour s’amuser et provoquer ?
Dryden Brown deviendra-t-il un jour PDG-roi, dirigeant un empire « alt-right » sur la Méditerranée ? J’en doute. Mais il existe bel et bien des efforts concrets pour créer des zones plus autonomes, des ports francs, des villes-charters. Si la démocratie vacille, le mouvement des États-réseaux semble déjà prêt à entrer en scène.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News