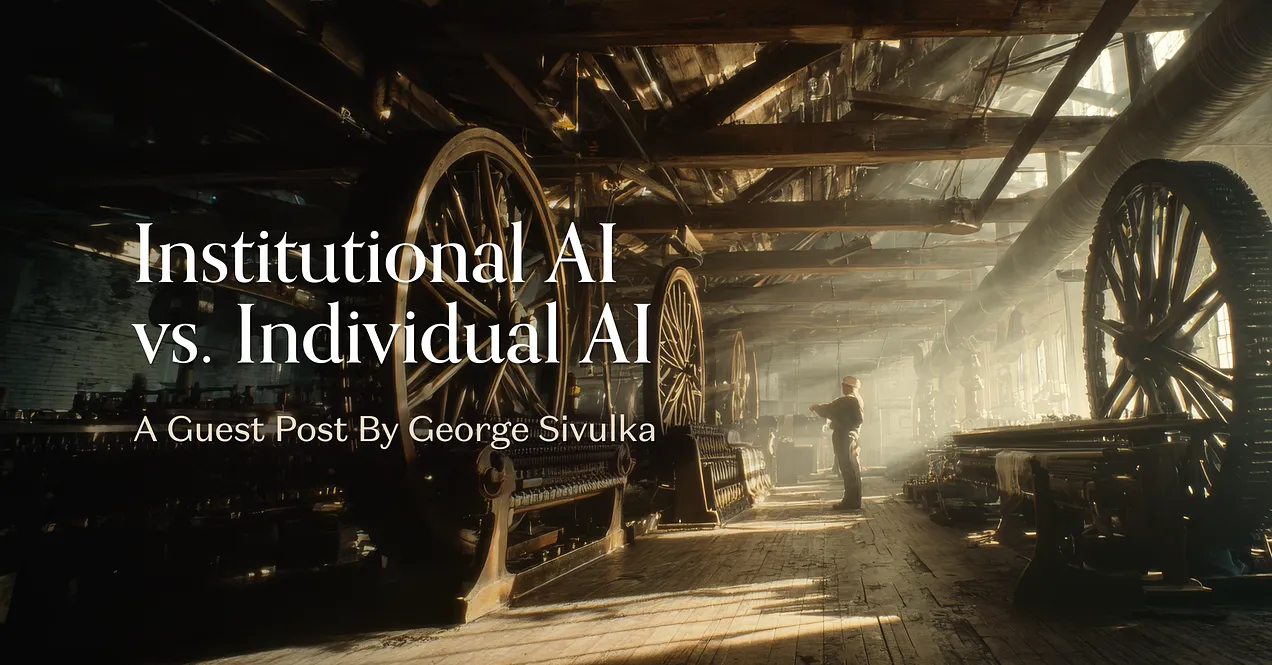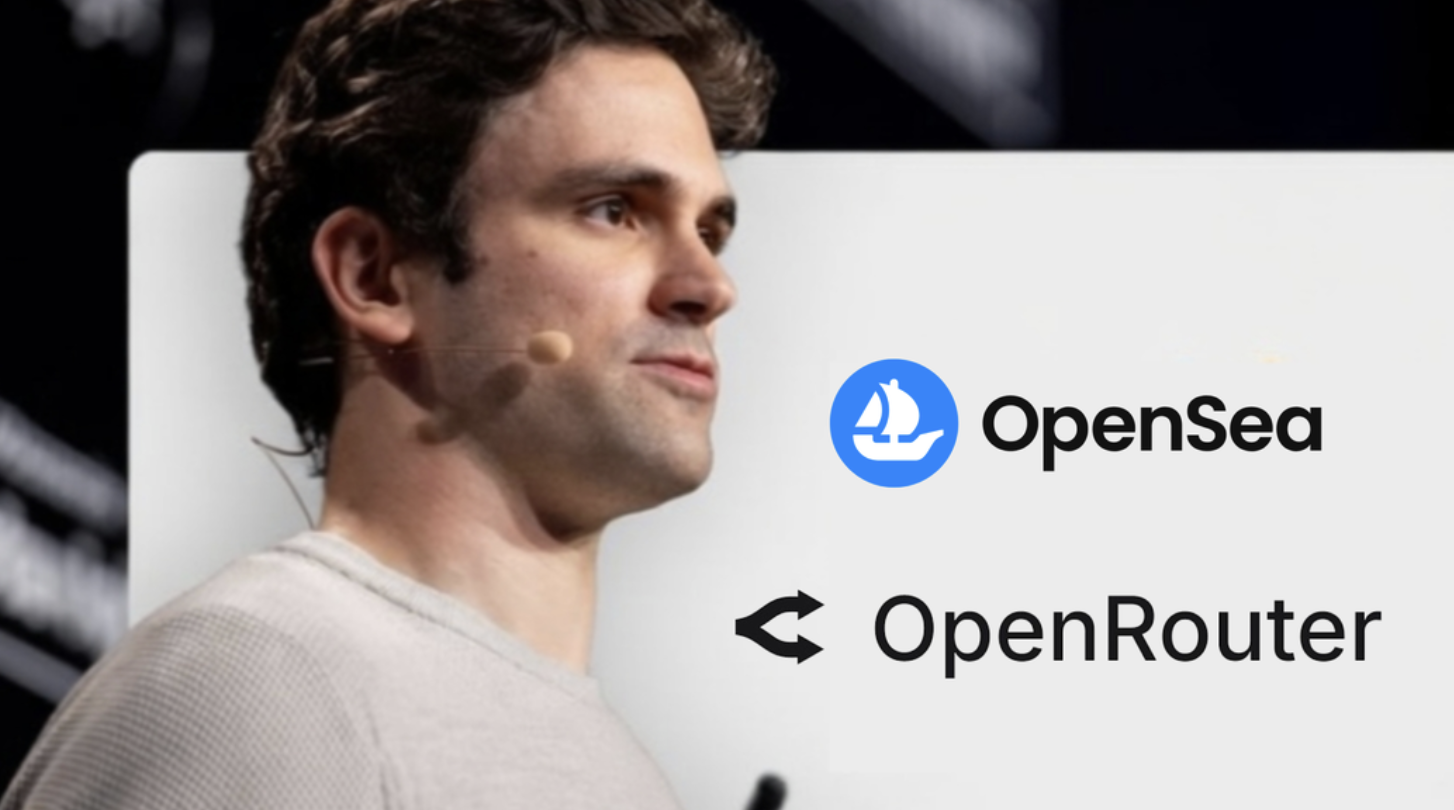Howard Marks : « Nous sommes désormais dans un territoire inconnu »
TechFlow SélectionTechFlow Sélection

Howard Marks : « Nous sommes désormais dans un territoire inconnu »
« Le développement des tarifs douaniers jusqu'à présent ressemble à ce que les amateurs de football appellent un « but contre son camp » — un joueur qui, par mégarde, marque un but dans son propre but, permettant ainsi à l'adversaire de marquer. »
Par Howard Marks, Co-fondateur et Co-président d'Oaktree Capital
Source : Oaktree Capital
*Publié le 9 avril 2025
Le vendredi 15 septembre 2008, peu après la clôture de la Bourse de New York, l'annonce soudaine du dépôt de bilan de Lehman Brothers a choqué le monde entier. Après les situations critiques de Bear Stearns et de Merrill Lynch, suivies par les crises successives de Wachovia, de Washington Mutual et d'AIG, les acteurs du marché ont rapidement conclu que le système financier américain était au bord de l'effondrement.
Il est devenu évident (contrairement à quelques jours auparavant) qu'une combinaison de facteurs pouvait entraîner un effondrement en chaîne des institutions financières :
(1) L'assouplissement de la réglementation financière ; (2) L'euphorie immobilière ; (3) Des prêts hypothécaires irrationnels ; (4) La transformation de ces prêts en milliers de titres structurés notés abusivement élevés ; (5) Les investissements massifs de banques fortement endettées dans ces titres ; et (6) Le risque de contrepartie généré par l'interdépendance étroite entre les banques. Une panique s'est installée, plongeant les marchés dans une spirale baissière apparemment sans fin.
J'ai alors estimé nécessaire d'exprimer mon point de vue sur ces événements et les perspectives à venir, publiant quatre jours plus tard une note intitulée « Nobody Knows » (« Personne ne sait »). Comme toujours, j'y reconnaissais mon ignorance totale quant à l'avenir — ignorance désormais encore plus grande, puisque les cadres antérieurs d'anticipation venaient d'être balayés. Personne ne savait si cette spirale allait s'arrêter, moi y compris. Néanmoins, j'en suis arrivé à la conclusion que nous devions supposer qu'elle finirait par cesser, et donc profiter des décotes massives sur les actifs financiers pour augmenter fortement nos positions.
Aucun d'entre nous, moi inclus, ne pouvait prétendre savoir ce qui allait se passer. Je ne pouvais qu'aboutir aux conclusions suivantes par inférence :
-
Nous ne pouvons pas connaître avec certitude quand surviendra la catastrophe finale,
-
Même si nous la connaissions, nous serions impuissants,
-
Tenter de s'y préparer pourrait, si elle n'advenait pas, provoquer une autre catastrophe,
-
Et surtout, dans la plupart des cas, la catastrophe finale n'arrive jamais.
Ces conclusions, bien entendu, ne reposaient sur aucune connaissance certaine de l'avenir. Mais hormis l'allocation de capitaux vers les marchés — notamment les 10 milliards de dollars non encore déployés du Fonds Opportunity VII B — je ne voyais aucun choix logique alternatif. Ce fonds avait précisément été créé pour saisir les grandes opportunités dans le domaine de la dette en difficulté. Et quand une telle opportunité se présente, surtout lorsque nous pouvons acquérir les meilleures dettes à fort rendement et à prix bradés, comment hésiter ? Nous devons toutefois admettre franchement que nous ignorons totalement ce qui va se produire.
Je ne peux pas prétendre analyser l'avenir. En fait, je pense que l'expression « analyser l'avenir » constitue en soi un énorme paradoxe. L'avenir n'a pas encore eu lieu et reste influencé par une infinité de facteurs complexes, impossibles à quantifier, imprévisibles et en constante évolution. Nous pouvons réfléchir à l'avenir, spéculer dessus, mais il est impossible de l'analyser — cela valait autant lors de la crise financière mondiale qu'aujourd'hui.
En mars 2020, j'ai repris le titre de ma note de 2008 pour publier « Nobody Knows II », ma première note durant la pandémie de COVID-19. J'y citais le point de vue du spécialiste des maladies infectieuses de Harvard, Marc Lipsitch : les décisions humaines reposent généralement sur trois piliers — (1) les faits vérifiables, (2) les inférences raisonnables tirées d'expériences passées comparables, et (3) les opinions ou spéculations. Or, face à la pandémie, ni faits ni expériences comparables n'existaient — nous étions réduits à la spéculation pure.
Concernant la crise de 2008, ainsi que d'autres turbulences de marché que j'ai vécues — y compris aujourd'hui — je dois dire que mes décisions n'étaient pas infaillibles et que j'agissais avec anxiété. Il n'existe aucune certitude en matière d'investissement, surtout aux moments de retournement ou de forte volatilité. Je n'ai jamais été convaincu que mon jugement était absolument correct, mais dès lors que j'arrivais à une conclusion logique, je devais avancer dans cette direction.
L’avenir incertain
Dans ma note confidentielle de février réservée aux clients, « 2024 in Review », j'avais qualifié le gouvernement Trump d'« imprévisible ». La pensée décisionnelle du président est plus difficile à anticiper que celle de ses prédécesseurs, principalement parce qu'elle ne suit pas nécessairement une idéologie cohérente et qu'elle fait souvent l'objet de réajustements tactiques. Cependant, il convient de noter que Trump critique depuis longtemps les désavantages commerciaux subis par les États-Unis dans les échanges mondiaux, et a défendu dès 1987 l'idée de droits de douane. Même si nous anticipions des hausses tarifaires, leur ampleur a largement dépassé toute attente. Manifestement, les marchés eux-mêmes n'y étaient pas préparés.
Les événements de la semaine dernière rappellent ceux de 2008 et la crise financière mondiale qui s'ensuivit. Toutes les règles sont remises en question. Le fonctionnement du commerce mondial tel qu'il s'est développé depuis 80 ans pourrait être radicalement transformé. L'impact économique, voire géopolitique, est totalement imprévisible. Nous sommes confrontés à des choix cruciaux, sans faits solides ni précédents historiques sur lesquels nous appuyer. Vraiment, personne ne sait — et une grande partie de cette note portera sur ce que nous ne pouvons pas savoir. Mais j'espère qu'elle vous aidera à clarifier votre pensée et à évaluer la situation.
Il faut souligner qu’il n’existe aucun véritable expert dans le contexte actuel. Certes, les économistes disposent d’outils et de modèles, mais aucune théorie ni modèle académique ne peut offrir une certitude ici. Aucune guerre commerciale à grande échelle n’a marqué l’histoire moderne ; toutes les théories restent donc non éprouvées. Investisseurs, entrepreneurs, universitaires et dirigeants politiques formuleront des recommandations, mais ils ne seront pas forcément plus pertinents qu’un observateur attentif lambda. Les conclusions évidentes sont connues de tous — par exemple, les prix vont probablement augmenter. Mais les vérités subtiles et cruciales demeurent insaisissables.
Je maintiens que même pour ceux qui tentent de faire des prévisions, les prévisions seules ne suffisent pas. Outre la prédiction elle-même, il faut évaluer la probabilité qu’elle se réalise, car toutes les prévisions n’ont pas la même valeur. Dans le contexte actuel, nous devons reconnaître que le taux de justesse des prévisions sera inférieur à la normale.
Pourquoi ? Parce que la situation actuelle regorge d’inconnues sans précédent, susceptibles de constituer le bouleversement économique le plus important de notre vie. Il n’y a ici aucune prémonition possible, seulement de la complexité et de l’incertitude, qu’il nous faut accepter. Cela signifie que si nous exigeons la certitude — ou même la confiance — comme condition d’action, nous serons paralysés. Autrement dit, pour parler franchement, si nous pensons prendre une décision indiscutable, nous avons probablement tort. Nous devons agir sans certitude.
Mais il faut aussi se souvenir que décider de « ne rien faire » n’est pas l’opposé de « faire quelque chose » — c’est en soi une action. Décider de ne pas agir — garder son portefeuille inchangé — doit être examiné avec autant de rigueur que la décision de modifier ses positions. Les maximes rassurantes utilisées par les investisseurs apeurés — « ne pas attraper un couteau qui tombe » ou « attendre que la poussière retombe » — ne peuvent servir de guide. J’adore le titre d’un livre de l’analyste de marché Walter Deemer : When the Time Comes To Buy, You Won’t Want To (« Quand viendra le moment d’acheter, vous n’aurez pas envie d’acheter »). Les événements négatifs qui causent les plus fortes baisses effraient les investisseurs et inhibent leurs achats. Pourtant, quand les mauvaises nouvelles s’accumulent, c’est souvent le meilleur moment pour agir.
Enfin, étant donné la nature tactique de la pensée de Trump, il faut garder à l’esprit que tout peut changer en un instant. S’il déclare victoire après avoir forcé des concessions, ce ne serait pas surprenant… Tout comme il serait logique qu’il intensifie les hostilités en réponse aux représailles d’autres pays. Comme je l’ai dit vendredi lors du forum de la Wharton School, si quelqu’un affirme savoir quel sera le niveau des droits de douane dans trois mois, je parierais qu’il a tort — sans même avoir besoin de connaître sa prévision précise.
Les droits de douane
Quels sont les objectifs du président Trump derrière ses politiques tarifaires ? Ses motivations sont-elles légitimes ? Le jour de l’annonce, j’ai entendu un commentateur télévisé dire que l’« impulsion » de Trump avait une certaine logique. Quels sont ses objectifs ? Ils incluent probablement une partie ou la totalité des éléments suivants :
-
Relancer l’industrie américaine
-
Encourager les exportations
-
Limiter les importations
-
Réduire, voire éliminer, le déficit commercial
-
Renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement via la production locale
-
Contrer les pratiques commerciales injustes vis-à-vis des États-Unis
-
Forcer d’autres pays à négocier
-
Générer des recettes pour le Trésor américain
Il faut reconnaître que chacun de ces objectifs est en soi souhaitable et représente un résultat plausible des politiques tarifaires.
Mais malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Le problème, c’est que le monde réel — particulièrement l’économie — produit des effets secondaires, voire tertiaires, qu’il faut également considérer. Sans ces effets, l’économie serait aussi fiable que les sciences physiques : « Si vous faites A, alors B arrive ». Comme disait le physicien théoricien Richard Feynman : « Imaginez à quel point la physique serait difficile si les électrons avaient des sentiments. »
Les économies et les marchés sont presque entièrement constitués d’êtres humains, qui ont effectivement des émotions et des réactions imprévisibles. En économie, d’autres acteurs réagiront à l’action A, puis à la conséquence B de cette action A, et nous devons anticiper leurs réactions. Ces impacts ne sont pas seulement significatifs, mais aussi difficiles à prévoir. De plus, la politique joue ici un rôle majeur et imprévisible, obéissant à sa propre logique.
Quelles pourraient être les conséquences des politiques tarifaires de Trump ? La liste est longue, et beaucoup sont graves :
-
Des représailles de la part d’autres pays
-
Une hausse des prix et une inflation accrue
-
Une baisse de la demande due à l’inflation et à la chute de la confiance des consommateurs
-
Des récessions et du chômage aux États-Unis et dans le monde
-
Des pénuries d’approvisionnement
-
Un bouleversement de l’ordre mondial
Il y a beaucoup de pistes à explorer, et si je tentais de toutes les développer, cette note n’en finirait jamais. Je vais donc en traiter quelques-unes brièvement.
Certains pays négocieront — après tout, selon la terminologie de Trump, les États-Unis ont souvent « les cartes en main » — mais d’autres refuseront, soit par posture dure de leurs dirigeants, entraînant une escalade. Imposer des « droits de douane réciproques » aura probablement peu d’effet positif, et risque plutôt d’aggraver la situation des deux côtés. Même si nous rencontrons moins de difficultés que les autres, cela ne sera guère réconfortant.
Incontestablement, les droits de douane feront monter les prix. Un droit de douane est une taxe sur les biens importés, dont quelqu’un doit assumer le coût. Cela concerne aussi bien les produits fabriqués à l’étranger que ceux fabriqués aux États-Unis mais contenant des matériaux ou composants importés. L’impact sera donc très large. Bien que les importateurs paient la taxe au port, ils transfèrent généralement le coût à l’acheteur final — le consommateur. Théoriquement, les fabricants, exportateurs, pays exportateurs ou importateurs pourraient absorber la charge fiscale pour maintenir leurs activités, mais ils n’auront aucune envie de rogner leurs marges bénéficiaires, et dans la plupart des cas, ils n’ont pas assez de marge pour le faire.
Il est utile de rappeler qu’en mars 2022, dans ma note « The Pendulum in International Affairs », j’avais souligné qu’entre 1995 et 2020, les prix des biens durables aux États-Unis avaient baissé de 40 % en termes réels, et l’inflation globale n’avait été en moyenne que de 1,8 % par an. Les biens durables comprennent les voitures, les appareils électroménagers et l’électronique, largement importés. Imaginez à quoi aurait ressemblé l’inflation si l’on avait limité ces importations bon marché ?
Mais si nous supposons que les trois grands objectifs susmentionnés sont atteints, conduisant à une production locale accrue des biens vendus aux États-Unis :
Premièrement, dans la plupart des cas, les États-Unis ne disposent pas d’une capacité manufacturière existante suffisante. Par exemple, je doute qu’il existe aux États-Unis des usines capables de produire des écrans de télévision ou d’ordinateur. Construire une capacité suffisante pour couvrir la majorité de la demande américaine prendrait plusieurs années, ce qui signifie des pénuries à court terme, ou des prix qui resteront probablement au niveau de « prix initial + droit de douane ».
Deuxièmement, les nouvelles usines créées pour redynamiser l’emploi industriel doivent traverser de longs processus d’autorisation et de construction, dont les coûts doivent être justifiés par des prévisions de profitabilité à long terme. Cela complique davantage les décisions, déjà affectées par les incertitudes liées à l’automatisation et à l’intelligence artificielle. Quel PDG s’engagerait dans un tel investissement uniquement sur la base de droits de douane susceptibles d’être renégociés — ou abolis par le prochain gouvernement ? N’oublions pas que Trump a signé, pendant son premier mandat, l’Accord USMCA entré en vigueur en 2020 pour remplacer l’ALENA de 1994, et qu’il remplace maintenant cet accord en imposant des droits de 25 % sur les marchandises mexicaines et canadiennes.
Troisièmement, le nombre de travailleurs qualifiés aux États-Unis pourrait ne pas suffire à remplacer ceux de Chine et d’autres pays en développement qui produisent actuellement ces biens.
Quatrièmement, pourquoi les Américains ont-ils initialement commencé à acheter des produits importés ? Parce qu’ils étaient moins chers. Pourquoi les emplois ont-ils disparu ? Parce que les salaires américains sont plus élevés pour un travail dont la qualité ne justifie pas un prix plus élevé. C’est précisément la raison pour laquelle les importations américaines de Volkswagen sont passées de 330 unités en 1950 à 400 000 en 2012. Pas à cause de droits de douane trop bas. La vérité simple est que les produits étrangers coûtent généralement moins cher que leurs équivalents fabriqués localement. Même si les droits de douane deviennent si élevés que « fabriqué aux États-Unis » coûte moins cher que « importé + droit de douane », le prix absolu restera supérieur à celui d’avant la taxation. En tout état de cause, le prix des produits locaux sera presque inévitablement supérieur à ce que les Américains ont l’habitude d’acheter en import.
Étant donné que la majorité des Américains ont peu de revenus disponibles après avoir payé leurs besoins essentiels, une hausse des prix pourrait réduire leur niveau de vie. À moins que les salaires augmentent en même temps, ce qui est peu probable, nous pourrions entrer dans une spirale inflationniste dangereuse.
La hausse des prix risque de réduire les ventes, comprimant ainsi les marges bénéficiaires. Mon économiste préféré (si tant est qu’un tel concept ait un sens, surtout venant de moi qui ne fais jamais de prévisions économiques) — Conrad DeQuadros de Brean Capital — considère que les marges bénéficiaires des entreprises sont le meilleur indicateur précurseur de récession. Quand les marges sont sous pression, les entreprises cessent d’investir, licencient et réduisent leurs coûts, ce qui déclenche souvent un ralentissement économique.
L’économie est essentiellement une science des choix, pleine de compromis. C’est particulièrement vrai dans les domaines du commerce et des droits de douane. Par exemple, selon de nombreux reportages récents (dont la véracité reste à confirmer), la hausse des droits sur les aciers importés en 2018 aurait permis de sauver 1 000 emplois dans l’industrie sidérurgique américaine. Mais les secteurs utilisant l’acier ont perdu 75 000 emplois (ou n’ont pas embauché les nouveaux employés potentiels). Comment trancher de telles décisions ? De même, comme je l’écrivais dans ma note de mai 2016, « Economic Reality » :
Comment peser l’intérêt des 3,2 millions d’Américains ayant perdu des emplois industriels à cause des produits chinois contre celui des milliers d’Américains qui doivent payer plus cher pour les produits importés ? Cette question est extrêmement difficile à répondre.
Dans tous les domaines économiques, plus l’anxiété est forte, moins les gens sont disposés à prendre des risques. Dans le monde d’incertitude que nous pourrions connaître, les gens pourraient hésiter, éviter les accords, et payer moins cher chaque unité de profit potentiel.
John Maynard Keynes décrivait l’activité économique comme mue par des « esprits animaux », qu’il définissait comme « une impulsion spontanée à l’action plutôt qu’à l’inaction, et non pas comme le résultat d’une moyenne pondérée des gains quantifiés multipliés par des probabilités quantifiées » (selon Wikipédia). Cette impulsion vient souvent de l’optimisme, peut-être reflété par la confiance des consommateurs. Alors, dans l’environnement futur, quelle sera la source de ces « esprits animaux » positifs ?
Une perspective internationale
Les effets des politiques tarifaires vont bien au-delà de l’économie ; ils touchent profondément la scène internationale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le commerce international a eu un impact extraordinairement bénéfique sur le monde entier. Grâce aux dépenses de reconstruction, aux progrès technologiques et managériaux, à l’amélioration des infrastructures, à l’expansion des marchés financiers et à la vague de mondialisation, une prospérité généralisée a été engendrée — un « effet de croissance pour tous ». Certes, certains pays et populations ont bénéficié plus que d’autres, mais tous ont gagné. Je crois que c’est l’une des principales raisons du relatif calme et de la prospérité générale des 80 dernières années. C’est pourquoi nous avons eu la chance de vivre dans la période la plus heureuse de l’histoire humaine.
Le principal avantage de la mondialisation s’appelle « avantage comparatif ». Chaque pays a des domaines où il excelle relativement ou produit à moindre coût, créant une complémentarité avec les autres. Si chaque pays se concentre sur la production de ses produits phares, les exporte, et importe les biens qu’il produit moins bien, le commerce international permet d’atteindre une efficacité maximale et donc un bien-être collectif accru. Comme je l’ai dit vendredi sur Bloomberg TV : « L’Italie produit des pâtes, la Suisse fabrique des montres, et nous en bénéficions tous. » Mais si, à cause de barrières commerciales, l’Italie doit produire ses propres montres et la Suisse ses propres pâtes, leurs habitants devront peut-être acheter des produits nationaux plus chers ou de moindre qualité — ou les deux.
Le fait que la plupart des biens coûtent moins cher à produire ailleurs, notamment dans les pays en développement grâce à des salaires plus bas, profite particulièrement aux Américains. Certes, cela a coûté des millions d’emplois, mais cela a permis à tous les Américains de vivre bien mieux que s’ils ne pouvaient acheter que des produits locaux. Voilà pourquoi la majorité des articles non alimentaires de Walmart sont importés.
Pour citer un autre facteur ayant contribué à un monde meilleur, j’ai décrit le comportement des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale comme « un égoïsme éclairé, accompagné de générosité envers le reste du monde ». Selon le plan Marshall, nous avons offert (et non prêté) des milliards de dollars aux pays d’Europe occidentale pour leur reconstruction. De même, entre 1945 et 1952, le général MacArthur supervisa la reconstruction et la relance économique du Japon. Depuis, les États-Unis ont (1) fourni une aide étrangère massive, (2) fortement investi dans les systèmes de santé des pays en développement, (3) encouragé les échanges éducatifs entre les États-Unis et d’autres nations, et (4) diffusé une image positive dans le monde entier. Ces actions reflètent une véritable générosité. Dans chacun de ces « échanges », nous avons donné plus que ce que nous avons reçu directement, ce que les cyniques pourraient qualifier de naïveté.
Oui, c’était de la générosité, mais comme le souligne le National Archives : le plan Marshall « a ouvert des marchés aux produits américains, créé des partenaires commerciaux fiables et aidé à établir des démocraties stables en Europe de l’Ouest ». Un excellent retour sur investissement. D’autres nations ont reçu une aide considérable, mais ces programmes ont indéniablement bénéficié aux États-Unis : ils ont limité l’expansion idéologique des adversaires, rapproché d’autres pays dans des alliances défensives, et aidé les États-Unis à devenir la nation la plus prospère au monde. Je ne souhaite pas voir les États-Unis devenir isolationnistes.
Mais : nous pourrions inverser ce processus.
Nous pourrions nous opposer à nos partenaires commerciaux, intimider et rançonner nos alliés.
Nous pourrions forcer les pays qui dépendaient de nous pour le capital et d’autres aides à se tourner vers la Chine et la Russie.
Nous pourrions amener d’autres nations à réduire leurs investissements aux États-Unis et à diminuer leurs détentions de bons du Trésor américain.
Les deux premiers points pourraient nous faire perdre des alliés essentiels et réduire l’attrait des régimes démocratiques. Comme me l’a dit mon ami Michael Smith : « On ne peut pas exercer une influence durable en se faisant des ennemis. » Le troisième point pourrait avoir un impact majeur sur les finances américaines.
Jusqu’à présent, la haute estime mondiale pour l’économie américaine, l’État de droit et la stabilité budgétaire nous a valu une « carte de crédit en or » : un crédit illimité, sans facture à payer. Cela nous a permis de fonctionner avec un déficit budgétaire chaque année depuis 25 ans, sauf quatre exceptions en 45 ans, et d’ajouter plus d’un billion de dollars de déficit annuel ces cinq dernières années. Autrement dit, nous avons pu vivre au-dessus de nos moyens — les dépenses fédérales dépassant régulièrement les recettes fiscales et autres. Résultat : la pire situation possible pour les États-Unis : une dette nationale de 36 billions de dollars, et un comportement extrêmement irresponsable du gouvernement fédéral.
Je ne m’attends pas à ce que le gouvernement fédéral devienne soudain responsable et équilibre son budget, donc je me demande combien de temps encore nous pourrons compter sur cette carte de crédit.
La volonté des autres pays d’acheter des bons du Trésor américain va-t-elle diminuer ? Vont-ils juger que notre gestion budgétaire n’est plus fiable ?
Même si nous conservons la meilleure notation mondiale, vont-ils réduire leurs achats par crainte, mécontentement ou motivation politique ?
Que se passera-t-il si une adjudication de dette échoue ? (J’imagine que la Réserve fédérale achètera les titres invendus, mais je suis mal à l’aise à l’idée que la Fed crée de la monnaie en créditant les comptes bancaires. Finalement, l’argent vient de où ?)
Si le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale diminue, conserverons-nous notre meilleure notation ?
Si les acheteurs de dette exigent des taux d’intérêt plus élevés, que deviendront les déficits (et la dette nationale) ? Jusqu’ici, une partie de nos déficits commerciaux a pu servir à acheter des bons du Trésor américain. Si cela cesse, que deviendront les taux d’intérêt américains ?
Depuis la Seconde Guerre mondiale, voire avant, les États-Unis ont toujours « eu les cartes en main ». Trump croit en la puissance américaine et en sa capacité à la monnayer. C’est ce qu’il fait avec ses politiques tarifaires : cesser de « payer pour le reste du monde ». Remplacer la générosité à long terme par des transactions censées rendre « valeur pour valeur ».
J’ai reçu de nombreux retours positifs après mon passage sur Bloomberg TV vendredi. Je voudrais conclure ce sujet avec le commentaire d’un spectateur :
Dans les années 1980, Peter Navarro [conseiller commercial et industriel de Trump] et d’autres pensaient que la domination japonaise dans l’automobile menaçait l’avenir des États-Unis.
Le Japon a effectivement dominé ce secteur et y est resté fort.
Mais depuis, l’économie américaine a plus que doublé celle du Japon. Même en tenant compte de l’évolution démographique et de l’appréciation monétaire, la croissance a été doublée. Malgré ce retard dans l’automobile, l’économie américaine a doublé — ou bien cette croissance est-elle en partie due à ce retard ? La marge bénéficiaire des logiciels informatiques et des moteurs d’avion est bien plus élevée que celle des voitures grand public. (Gras ajouté par l’auteur)
Le Japon a exploité son avantage dans la production automobile, tandis que les États-Unis se sont tournés vers d’autres secteurs où ils pouvaient exceller. N’est-ce pas là précisément le fonctionnement dynamique d’une économie mondiale en bonne santé ?
Comme je le demandais dans ma note de septembre, est-il sage que le gouvernement cherche à dominer les lois économiques, forçant une économie qui, sans intervention, suivrait son cours naturel, à obéir à des préférences politiques ? Un droit de douane est un « facteur extérieur » ou « artificiel » destiné à : (1) freiner des exportations qui sinon auraient lieu, afin de (2) aider des entreprises nationales à réaliser des ventes qu’elles n’auraient pas réalisées librement. Quel est le coût, et qui le supporte ?
Conclusion
À mes yeux, les récents développements tarifaires ressemblent à ce que les supporters de football appellent un « but contre son camp » — un joueur qui, par erreur, marque dans son propre but. Cela rappelle fortement le Brexit, dont nous connaissons déjà les conséquences. Le Brexit a coûté cher au Royaume-Uni en termes de PIB, de moral et d’alliances. Il a nui à la réputation et à la stabilité du gouvernement. Tout cela est le fruit de ses propres décisions.
J’ai apprécié la manière dont les choses ont fonctionné de mon vivant, qui couvre précisément 99 % de la période post-guerre que j’évoque. Certes, une partie des dépenses publiques a été gaspillée, chez nous comme à l’étranger, et notre dette nationale n’est pas une fierté. Mais j’ai aimé vivre dans un monde de paix, de prospérité croissante et de santé améliorée, et je ne souhaite pas voir cela changer. Il y a quelques mois à peine, l’économie américaine était solide, l’avenir optimiste, les marchés boursiers atteignaient des sommets historiques, et on parlait partout de l’exceptionnalisme américain. Aujourd’hui, si les droits de douane de Trump entrent pleinement en vigueur, l’économie américaine pourrait plonger plus vite en récession, avec une inflation plus élevée et des perturbations économiques généralisées, que dans toute autre circonstance. Même si les droits étaient entièrement annulés, les autres pays ne pourraient ignorer cet épisode et concluraient probablement qu’ils doivent réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Il est indéniable que certaines des cibles listées plus haut pourraient être atteintes. L’industrie américaine pourrait croître, créer de nouveaux emplois et renforcer la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Le traitement des États-Unis dans le commerce mondial pourrait devenir plus équitable. Les recettes du Trésor pourraient augmenter.
En revanche, certains bénéfices escomptés pourraient rester hors d’atteinte. Notamment, en ce qui concerne la réduction du déficit commercial : tant que les États-Unis seront plus forts, plus prospères et donc plus acheteurs, ils importeront probablement plus qu’ils n’exporteront. Les salaires américains plus élevés impliquent que les produits fabriqués aux États-Unis coûteront probablement plus cher que leurs équivalents étrangers.
Les résultats escomptés pourraient se produire, les effets négatifs aussi, ou les deux à la fois. Mais il faut se souvenir que tout bénéfice pourrait prendre des années à se manifester, tandis que les coûts seront probablement immédiats.
Et les marchés financiers ? Ces derniers jours, les perspectives économiques ont radicalement changé, entraînant une forte baisse boursière. Comme toujours, la question centrale est de savoir si la réaction actuelle des marchés est appropriée : exacte, excessive ou insuffisante ? Cette question est encore plus difficile à répondre, car presque personne ne croit que le monde économique futur ressemblera à celui dans lequel nous avons vécu jusqu’ici — et il pourrait même être pire. D’un côté, si les droits annoncés sont maintenus et que les représailles entraînent une guerre commerciale totale, les conséquences économiques pourraient être sévères. De l’autre, si la raison (et une correction politique et boursière forte) l’emportent, les droits pourraient être ramenés à des niveaux moins dommageables, voire apporter des gains au libre-échange.
Comment la Réserve fédérale réagira-t-elle ? Le risque de récession pourrait pousser à des baisses de taux plus agressives pour stimuler l’économie. Ou bien la menace inflationniste pourrait retarder les baisses prévues. Mais attention : les hausses de taux, typiquement utilisées contre l’inflation, pourraient être moins efficaces contre une inflation causée par des droits de douane qu’contre une inflation classique tirée par la demande. Le titre d’aujourd’hui convient parfaitement à la Fed : vraiment, personne ne sait.
Dans les marchés où intervient Oaktree, les craintes de défaut (pas sans fondement) ont fait nettement augmenter la compensation pour risque sous forme de spread, entraînant une hausse significative des rendements créditeurs disponibles. Par ailleurs, nous prévoyons une augmentation du taux de défaillance et une demande accrue pour des solutions de capital sur mesure. Notre dernier fonds de dette opportuniste devrait probablement accélérer son déploiement.
Pour paraphraser Mark Twain, l’histoire rime toujours. Ainsi, comme j’ai repris le titre de ma note post-Lehman pour celle-ci, je vais aussi reprendre sa conclusion :
Il y a 18-24-36 mois, tout le monde achetait activement des actifs, la situation semblait claire, les prix montaient en flèche. Aujourd’hui, des risques inimaginables sont proches et déjà intégrés dans les prix ; acheter des actifs avec décote est logique : les trésors d’hier sont jetés par les investisseurs (les bébés jetés avec l’eau du bain). Nous déployons activement nos capitaux.
Personnellement, j’ai eu la chance de rencontrer des investisseurs à Montréal le jour de l’annonce des droits de douane, puis à Toronto le lendemain. Quel hasard providentiel ! J’ai commencé chaque entretien en disant que, comme des centaines de millions d’Américains, je respecte le Canada et le considère comme un partenaire et un allié. Les réactions ont été émouvantes. C’est précisément l’occasion pour nous tous de renforcer nos liens avec nos amis du monde entier.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News